Mexique : les militaires aux commandes
La gauche gouverne au Mexique. L’élection d’Andrés Manuel López Obrador en 2018 a mis fin à plus de trente ans de néolibéralisme forcené. Durant les six ans de sa présidence, quelque cinq millions de Mexicains sont sortis de la pauvreté, le salaire minimum a presque doublé et les personnes âgées de plus de 65 ans ont gagné le droit à une retraite universelle. En 2024, une femme lui a succédé, Claudia Sheinbaum, une première dans l’histoire du pays. La nouvelle présidente, scientifique de formation, incarne la continuité du projet réformateur de la gauche au pouvoir. Elle a brillamment tenu tête aux annonces agressives de la seconde administration Trump et a lancé un plan national de développement très ambitieux.
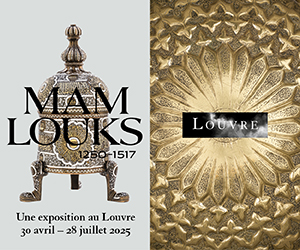
Cependant, dès son arrivée au pouvoir, la gauche s’est largement appuyée sur les militaires pour mener à bien ses politiques. Bien que le candidat López Obrador avait promis qu’il renverrait les soldats dans leurs casernes durant la campagne électorale de 2018, il a non seulement renié cet engagement une fois élu président, mais, d’une façon tout à fait improbable, une alliance civique-militaire a vu le jour, avec des effets inattendus. Résultat, alors que le budget annuel des forces armées et celui combiné des institutions de police et de justice étaient encore à l’équilibre en 2014 (autour de 120 milliards de pesos chacun), avant l’arrivée au pouvoir de la gauche, huit ans plus tard, en 2022, le premier avait quasiment doublé (dépassant les 200 milliards) et représentait désormais un budget quatre fois supérieur au second (réduit à 55 milliards).
Comment comprendre un tel revirement ? Pourquoi la gauche mexicaine, une fois installée au gouvernement, s’est-elle convertie au militarisme ? Quelles sont les raisons de cette alliance, en apparence contre-nature ? Quelle logique se trouve derrière cette nouvelle forme de militarisation ?
La guerre contre la drogue
La militarisation n’est pas en soi quelque chose de nouveau dans l’histoire du Mexique. E
