Cuba durant la « période spéciale », bifurcation socio-écologique ?
Nos systèmes productifs minent, abattent, forent, détruisent, rejettent, déversent des quantités gigantesques de matière et d’énergie pour entretenir une course en avant de plus en plus éloignée du caractère satisfaisant des conditions de vie.
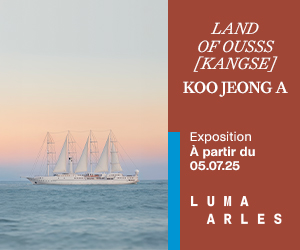
Les origines socio-économiques de cette pression matérielle insoutenable commencent à être bien établies. Ce ne sont pas n’importe quelles sociétés ni « l’humanité » qui ont ravagé les territoires et la biodiversité, pollué les sols et l’air, et qui maintenant provoquent une dérive climatique d’une rapidité inédite[1]. Ce que l’on observe, ce sont des dynamiques d’appropriation et d’exploitation de la nature (et de l’humain) à l’œuvre depuis les origines des capitalismes et indissociables de leur expansion[2]. La voie officiellement proposée de « verdir » des productions et des usages inchangés, au seul prisme des émissions de CO2 et du climat, peine à susciter l’entrain populaire.
Mais si l’on comprend les structures sociales du problème, celles des solutions sont encore largement sujettes à spéculation. À quoi ressembleraient des sociétés désirables en équilibre avec leur environnement ? Quelles structures sociales permettraient de diminuer l’assise énergétique et matérielle tout en garantissant des conditions de vie satisfaisantes ?
Des éléments de réponse à ce problème peuvent se trouver dans des expériences passées. On peut s’aider en regardant les transformations de sociétés qui ont réduit rapidement et fortement les flux d’énergie et de matière qui irriguent leur système de production tout en affichant une amélioration des conditions de vie. Bien sûr, dit ainsi, la situation paraît évidente : si de tels exemples parfaits étaient connus, le problème serait déjà réglé. De fait, ils n’existent pas encore. Mais on peut trouver des cas qui s’en approchent, qui présentent certains aspects et qui permettent d’observer des dynamiques imparfaites mais réelles.
Cuba nous offre un tel cas d’étude. Durant les années 1990,
