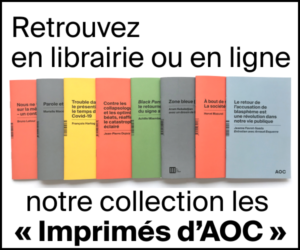La Grande-Bretagne et la France en Afrique : une entente fort minable ou formidable ?
Lors du sommet franco-britannique de 2023, le Royaume-Uni et la France se sont engagés à « intensifier leurs efforts conjoints » et à « renforcer leur coopération » en Afrique, notamment au Sahel, dans la Corne et dans la région des Grands Lacs. Cette volonté de coopération contraste fortement avec les récentes querelles autour du Brexit et la rivalité franco-britannique, bien plus ancienne, sur le continent africain[1]. Cet article s’interroge sur la manière dont la Grande-Bretagne et la France ont réussi, depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours, à surmonter leurs différences et à travailler ensemble en Afrique.
Histoire de la rivalité
L’origine de la rivalité franco-britannique en Afrique est souvent attribuée à l’incident de Fachoda de 1898, lorsque la France fut contrainte de battre en retraite de manière humiliante et de céder à la Grande-Bretagne ses revendications territoriales sur le Soudan. L’entente cordiale de 1904 n’apaisa que partiellement le ressentiment entre les deux pays, le « syndrome de Fachoda » (la paranoïa de la France face à la pénétration anglophone en Afrique francophone) persistant.
Cet esprit de non-coopération perdura jusqu’aux premières décennies postcoloniales, la Grande-Bretagne et la France poursuivant leurs propres approches étroites de realpolitik. À titre d’exemple, plutôt que de collaborer pour réduire la pauvreté en Afrique, ces anciennes puissances coloniales lièrent des volumes importants d’aide étrangère à l’achat de leurs propres produits et services. Elles promurent également des modèles idéologiques de développement économique différents : le Royaume-Uni soutenait des réformes néolibérales impulsées par la Banque mondiale, tandis que la France s’opposait au soi-disant « consensus de Washington[2] ». De même, ils léguèrent à leurs anciennes colonies respectives des systèmes politiques différents, puis fermèrent les yeux lorsque ces dernières devinrent des États à parti unique. Sur le plan sécuritaire, le Royaume-Uni et