Les COP régionales : une reprise en main de la planification territoriale par l’État ?
Face à l’urgence climatique et la nécessité d’organiser une bifurcation écologique, une expression est apparue depuis quelques années, celle de « planification écologique ». Des travaux académiques se multiplient mettant en avant la pertinence de l’idée de planification pour organiser cette bifurcation écologique, qu’on songe à l’ouvrage de Cédric Durand et Razmig Keucheyan[1] ou encore à celui de Mathilde Viennot[2] sur la mise en place d’une planification écologique comme scénario de bifurcation.
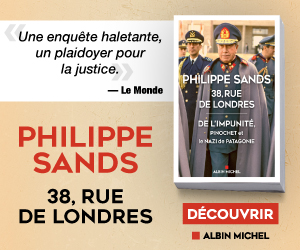
Les réflexions autour d’une planification écologique mettent en évidence la nécessité de porter également une analyse sur celles-ci à l’échelle territoriale pour prendre en compte la singularité des territoires, mais aussi parce que les territoires sont en première ligne de l’effondrement écologique. D’ailleurs, les territoires ont un long héritage en matière de planification de leur aménagement (Régions, EPCI, etc.), fruit de la décentralisation, et communément désignée par planification territoriale (PT).
Au-delà de la littérature scientifique, les politiques publiques se sont réemparées de la question, réhabilitant le terme de planification avec la création en 2022 d’un Secrétariat Général à la Planification Écologique (SGPE) placé sous l’autorité du Premier ministre. Ce dernier s’est vu attribuer la mission « d’assurer la cohérence et le suivi des politiques à visée écologique, d’initier et de cadrer la mobilisation des ministères et parties prenantes, de coordonner toutes les négociations et enfin de mesurer la performance des actions menées. » L’année suivante, en vue de déployer les actions formulées dans son plan « France Nation Verte », le SGPE annonçait la mise en place de dispositifs de planification à l’échelle territoriale : les Conferences of the Parties régionales (COP régionales). Celles-ci doivent permettre « d’accélérer la transition dans les territoires » à l’aide d’une nouvelle méthode.
A priori, on pourrait penser que les COP régionales cons
