L’autre radicalisation : décrypter l’ultradroite à l’aune du djihadisme
À la fin du mois de septembre, les seize membres du groupuscule Action des forces opérationnelles (AFO) ont comparu devant la justice pour avoir préparé des attaques et des projets d’empoisonnement visant des citoyens de confession musulmane.
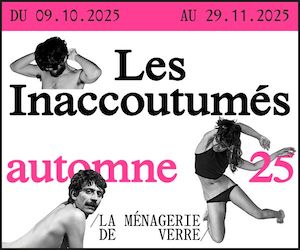
Après l’assassinat en 2025 d’Aboubakar Cissé, en plein cœur de la mosquée de la Grande Combe dans le Gard, et celui d’Hichem, un Tunisien tué à Puget-sur-Argens, ce procès vient rappeler qu’à l’inverse de la violence à référentiel djihadiste, les trajectoires similaires au sein de l’ultradroite demeurent largement inexplorées.
Pourtant, les chiffres sont sans appel : selon le Global Terrorism Database, les violences attribuées à ces mouvances ont augmenté de près de 320 % dans les sociétés occidentales entre 2015 et 2019. En dépit de cette expansion internationale plus que significative, la recherche française consacrée à ces nébuleuses peine encore à investir ce sujet. Alors que les structures partisanes d’extrême droite sont l’objet d’une littérature scientifique abondante, les trajectoires sociales de leurs militants les plus violents restent dans l’ombre. Plusieurs raisons expliquent cette carence : le faible nombre de condamnations et, par conséquent, de détenus observables ; les obstacles institutionnels qui compliquent l’accès au terrain carcéral ; la priorité accordée aux profils islamistes jugés plus menaçants ; et parfois la réticence de ces acteurs à témoigner de leurs parcours. Cette asymétrie analytique est aisément quantifiable.
Depuis les années 2000 des centaines de thèses francophones ont été consacrées à l’islamisme radical quand celles relatives à l’ultradroite peinent à atteindre la dizaine. Résultat : alors que la recherche sur le djihadisme s’est considérablement enrichie et affinée – en explorant les trajectoires d’engagement, l’influence des outils numériques, le rôle des émotions ou encore les processus de désengagement – l’extrême droite continue d’être principalement étudiée sous le prisme d
