Homo faber et logique des affaires
Après le contrat social, au principe de notre utopique modernité politique, et le contrat naturel, au cœur de notre nouvelle identité terrestre selon Michel Serres, vint le pacte écologique, apparu à la faveur de l’élection présidentielle de 2007, si habilement proposé que (quasi) tous les candidats en vue furent « obligés » de le signer.
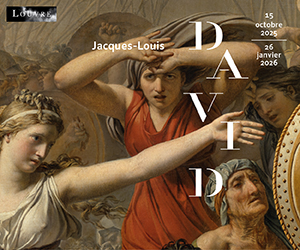
Que dit cette permanence de la figure du contrat à propos de notre vision du politique : de couleur si juridique ? De notre conception de la justice : à ce point transactionnelle, structurée par les « deals » ? De notre appréhension de la nature : à ce degré apprivoisée dans ses humeurs et ses fruits, qu’elle en devient un « co-contractant », avec lequel négocier la transition écologique ?
Passion étrange pour la logique contractualiste, plus singulière encore à gauche, puisqu’elle fonde l’instrument principal des privatisations et justifie les plus vils négoces, jusqu’à commander aujourd’hui les grands mouvements du droit international par la « grâce » du « dealer ! en chef », Donald Trump, nous y reviendrons.
Une approche servant à merveille l’homme affairé, animé par un esprit d’appropriation, depuis John Locke au moins, au principe de nos systèmes politiques libéraux, à leur acmé par notre soumission au marché, plus même contrôlé depuis la survenue du néolibéralisme, une agitation économique en rien renouveau du libéralisme, bien plutôt son dévoiement en des démocraties illibérales et des acteurs économiques irresponsables : « s’approprier » les bénéfices mais « publiciser » les pertes, voilà son esprit.
Voilà la lâcheté érigée en vertu économique et politique, qui connaît ses prouesses et ses héros, les directeurs du Crédit suisse par exemple, deuxième établissement bancaire de l’Helvétie, aux bonus acquis… d’une entreprise en quasi-faillite ; qui connaît ses sentences proverbiales : de l’arrogance du too big to fail, à la croyance en un « marché » d’âme doté qui craint, souffre ou s’affole… Égarée la rationalité de
