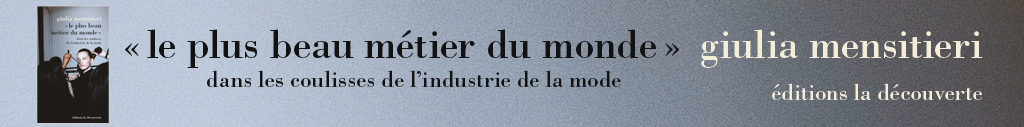Bovary en liberté
1857, année juridique : on y vit se tenir successivement deux retentissants procès littéraires pour outrage aux bonnes mœurs, à la religion et à la morale publique – celui de Baudelaire pour Les Fleurs du mal, celui de Flaubert pour Madame Bovary. Et si le poète fut condamné, et le romancier – plus influent, mieux représenté – acquitté, la coïncidence de ces deux procès prend valeur de commun symbole : celui d’une littérature en mutation, élaborant des formes nouvelles dont l’irruption remet en cause les modalités selon lesquelles on pensait jusqu’alors la représentation du réel, le rapport de la forme littéraire à la morale, la responsabilité de l’écrivain. On sent que c’est de ce moment fascinant qu’a voulu s’emparer Tiago Rodrigues en montant son spectacle Bovary, subtil et vertigineux montage d’extraits du roman, des plaidoiries du procès que Flaubert prit soin de faire sténographier, et de la correspondance de l’écrivain qui rend compte à ses amis de ses différends judiciaires. On comprend aussi immédiatement pourquoi cette mise en question de la puissance de répercussion de la littérature dans les deux sphères intimes et publiques, même si elle est interrogée ici à partir d’un roman, peut intéresser spécifiquement un homme de théâtre – et plus spécifiquement encore peut-être Tiago Rodrigues, auteur, acteur, metteur en scène prolifique, actuel directeur du Théâtre National de Lisbonne, qui a toujours défendu une vision politique de l’art dramatique et qui a monté Bovary en 2016 pour répondre à une proposition d’« occuper » temporairement le Théâtre de la Bastille.
Sur scène, donc, au départ, cinq personnages – Gustave Flaubert, les deux avocats pro et contra, Emma et son mari Charles Bovary. Un plateau nu, au sol jonché d’une multitude de pages, comme pour mieux suggérer à quel point se trouvent ici mêlées au plus intime la lecture et la vie. Pour tout décor, quelques portants auxquels sont suspendus des disques de verre, qui évoquent les assiettes