Nous sommes entrés dans l’ère de l’Après littérature –à l’instar d’Antoine Wauters.
« La littérature est morte » : tel serait le noir postulat de notre contemporain. Cette considération liminaire d’une disparition de la littérature enfin prise au sérieux et véritablement advenue à l’écriture est celle qui a déterminé l’ensemble de mon propos dans Après la littérature, essai qui vient de paraître sur l’écriture contemporaine. De fait, cette mort de la littérature, qui occupe les esprits depuis la fin du XXe siècle, est toujours repoussée au loin par nombre d’écrivains à la manière d’un mauvais rêve éprouvant que l’on pourrait dissiper au réveil afin de continuer à écrire comme si rien ne s’était effectivement produit.
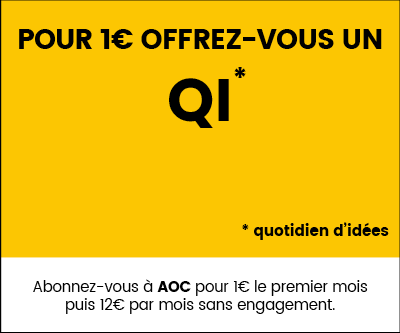
Cependant, loin de se réduire à un vil fantasme, la mort de la littérature a bel et bien eu lieu. En effet, écrire aujourd’hui revient à écrire dans un grand Après, dans un moment sans équivalent où la littérature française a comme succombé à elle-même, où elle s’est effondrée jusqu’à l’effacement le plus résolu, où elle gît à nos pieds comme notre grande et menaçante disparue. Tout se passe comme si commencer à écrire aujourd’hui consistait à entrer dans un temps inouï, celui d’une post-littérature qui aurait enfin perçu combien tous les grands livres avaient déjà été écrits et que l’écriture était, fatalement et terriblement, derrière chacun de nous. Comme si notre présent débutait précisément à l’instant où la mort de la littérature avait fini par advenir.
Car si littérature contemporaine il y a, sans doute est-ce parce que certains écrivains, plus que d’autres, endurent avec violence le temps présent qui leur échoit comme une ère d’après littérature tant il s’agit pour eux de ne plus faire comme si la littérature n’était pas morte. La grande et si redoutée disparition de la littérature a eu lieu. Mais sans doute convient-il de distinguer plusieurs morts de la littérature afin de comprendre pourquoi, depuis le début des années 2000, la littérature est emportée par une puissante métamorphose de ses paradigmes poétique, critique et r
