Dorothea Lange au Jeu de Paume : invisibles « politiques du visible »
Quand Ansel Adams (1902-1984) disait que les images de Dorothea Lange (1895-1965) incarneraient la Grande Dépression pour l’avenir, lui dont les paysages des Rocheuses sont devenus des icônes de l’espace américain, il avait probablement compris ce qui, aujourd’hui encore, fait la puissance de ces photographies. L’image de la Mère migrante (1936) a acquis une notoriété visuelle qui la place dans le petit nombre des photographies les plus connues au monde, même de ceux peu versés dans l’histoire de la photographie. Certes, l’œuvre de Dorothea Lange, qui s’étend sur presque quatre décennies, ne saurait se limiter à cette seule image. Pour autant, elle contient aussi toute sa photographie et aurait pu constituer un axe central de lecture d’une exposition qui en manque un peu.
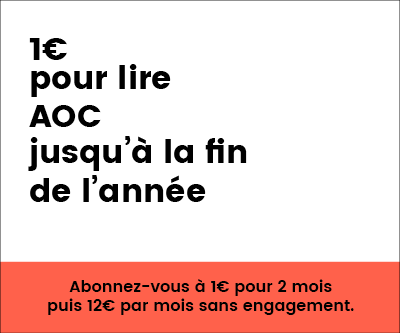
Car Dorothea Lange est une formidable portraitiste (c’est ainsi qu’elle débute en photographie à la fin des années 1910) qui sait saisir avec autant d’acuité le visage des gens du commun, et surtout leurs gestes, de même que Walker Evans excellait dans l’exploration et la valorisation du vernaculaire américain. La séquence des prises de vues de la « Mère migrante » et ses enfants, de son nom Florence Thompson, clairement présentée sur un mur dédié de l’exposition, nous montre une photographe à la recherche du cadrage parfait : celui qui va exprimer ce qu’elle perçoit comme la « vérité d’une situation » et le concentrer, après quelques tentatives, dans une photographie qui fait directement écho à l’iconographie de la peinture religieuse.
Pourtant, ici, au Jeu de Paume, le spectateur non spécialiste a du mal à comprendre que se joue à la fois la force et la limite de l’image documentaire, toute son ambiguïté. Car cette présentation ne prend pas en compte la question des légendes successives, plus ou moins informatives ou erronées, débouchant enfin sur le fameux titre métonymique (« Mère migrante »), donné par la presse et non par Lange ; pas plus qu’elle ne rattache ce travail sur la forme à celui d
