Pour qu’enfin nos langues bandent ensemble – à propos de Maroc : la guerre des langues ?
Le Maroc, c’est pratique : tout est en français. Les noms des hôtels sont des noms français, les noms des rues sont en français, les publicités sont en français, les menus des restaurants sont naturellement en français, les noms des magasins et les titres des quotidiens, sans compter que n’importe quel Marocain en uniforme vous répondra en français. Bref, on est comme chez soi, et en plus c’est moins cher.
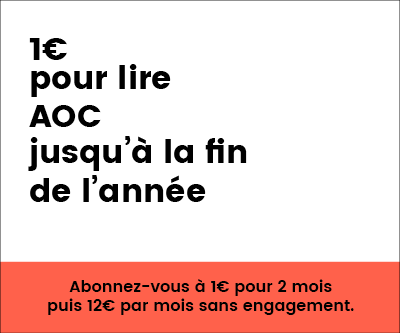
Évidemment, si vous demandez votre chemin à un Marocain quelconque, il ne comprendra rien et vous répondra gentiment dans une langue inconnue, qui n’est même pas de l’arabe, mais une langue vernaculaire, la darija, qui ne semble guère intéresser que les linguistes et les anthropologues. C’est que le Maroc n’est pas fait pour les Marocains quelconques. Bien sûr, les Marocains non-quelconques parlent également cette langue vernaculaire, mêlée de termes français. Ainsi, vous reconnaîtrez avec plaisir et intérêt dans une conversation en arabe des mots comme entreprise, ou bien ressources humaines, ou encore (si vous avez des amis artistes) résidence et bourse. Car le français est au Maroc ce que l’anglais est en France : la langue du bizness. Au Maroc, on parle pognon en français.
Heureusement, nous disposons tous, Français comme Marocains, d’un cache-sexe qu’on appelle la « francophonie ». Le personnel français en poste au Maroc indiquera d’un index à la fois autoritaire et gourmand à l’œil du visiteur la direction de son cache-sexe, lui recommandant premièrement d’en admirer à la fois la solidité et l’ancienneté, deuxièmement de ne pas y toucher — ce en quoi il ne perd rien, vu qu’en dessous ça ne bande pas.
Ce français qui ne bande pas ou qui bande mou depuis des décennies, nous en savons en France quelque chose : c’est le français d’entreprise, certes, moins sensible qu’un fer à repasser, mais c’est aussi le français de qualité, faussement oralisé, de la plupart des romans bien en place, dont les thèmes varient en fonction de l’actualité. Ce sont ces livres-là qu
