L’humanité hors du temps – sur Sécheresse de J. G. Ballard
Que nous dit Ballard aujourd’hui dans Sècheresse ? Ce roman de « science fiction » publié en 1964 décrit un monde aride où le cycle de la pluie est interrompu : l’océan est couvert de granules de plastique générés par les « immenses quantités de déchets industriels déversés depuis cinquante ans ». Les nuages ont disparu. Le soleil est écrasant. Les forêts brûlent. Ce n’est pas exactement ce qui nous arrive au bout de ces cinquante ans, mais l’idée y est.
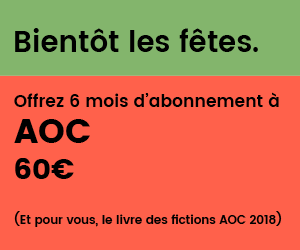
Sécheresse est un roman déroutant. L’errance du héros, Ransom, est si décousue qu’on peine à le suivre, et je soupçonne que Ballard, en bon écrivain, se plaise surtout à décrire un monde, sans s’attacher aux péripéties. La psychologie égarée de son personnage est à la fois réussie (elle reflète le désastre) mais invraisemblable : on a du mal à s’identifier à cet assoiffé durable. Ce n’est pas tant la soif qui le guide que des mobiles contradictoires, des amours inachevées, des amitiés trahies, des fascinations éphémères, des alliances rompues. D’ailleurs The Drought (Sécheresse) n’a jamais été adapté en film, contrairement à d’autres romans de Ballard. C’est sans doute son défaut de vraisemblance psychologique qui empêche d’en tirer un bon scénario, faute d’unité dans le personnage-point de vue. Mais qu’attendre de la psychologie dans un monde sens dessus dessous, où les lacs se creusent en désert et la mer se couvre de sel ? Les fous deviennent rois, les femmes rugissent, les puissants crèvent, et un « travesti androgyne » (le vocabulaire est de 1964) devient le propriétaire de la dernière mare. Ballard tâtonne et va bizarrement droit au but, avec la force d’un héritier de Shakespeare. Quand la première ressource dont a besoin Sapiens Sapiens, l’eau, vient à manquer, c’est l’humanité toute entière qui se pulvérise dans le bruit et la fureur.
Charles Ransom, le héros errant, rencontre Catherine, qui s’évertue à abreuver les animaux du zoo. Au cinéma, il faudrait qu’elle soit jouée par une femme au visage aigu, sans
