Une autre Pologne : à propos des Livres de Jakób d’Olga Tokarczuk
En 2014 paraît en Pologne le roman d’Olga Tokarczuk, Les Livres de Jakób ou le grand voyage à travers sept frontières, cinq langues, trois grandes religions…. [1]. Le titre, qui se déploie à la manière baroque sur toute la page de garde, annonce déjà cette entreprise de démesure : douze livres, plus d’un millier de pages, six années de travail de recherches et d’écriture, récompensées par le prestigieux prix Nike (Goncourt polonais) en 2015, déclenchant en Pologne un débat dépassant des enjeux littéraires, mais couronné aussi, en 2018, par le prix de Jan Michalski (fondation suisse), une nomination au prix Femina, une mise en scène dans un théâtre varsovien [2]…
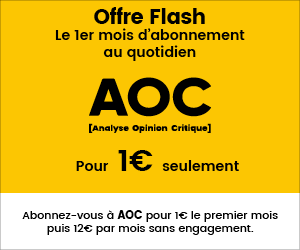
Bref, un livre qui n’est passé inaperçu, ni en Pologne, ni à l’étranger. Olga Tokarczuk (née en 1962) fait partie des auteurs polonais relativement bien connus en France. Cinq de ses romans ont déjà été traduits : Dieu, le temps, les hommes et les anges, Maison de jour, maison de nuit, Récits ultimes, Les Pérégrins, (Prix Man Booker international 2018) et Sur les ossements, des morts, (un roman policier qui a inspiré le film d’Agnieszka Holland, Spoor, 2017). Les Livres de Jakób constituent son opus magnum, non seulement par leur ampleur mais aussi par le prolongement de certains thèmes présents dans ses livres précédents : temps, histoire, voyage, quêtes identitaires et transgressives, déplaçant cette fois le questionnement de l’individuel vers le collectif.
L’endroit du décor : le XVIIIesiècle polonais dans l’imaginaire collectif
Cet ambitieux roman, recouvre un demi-siècle de l’histoire polonaise dans la deuxième moitié du XVIIIe. Il s’agit d’une période particulière, associée à l’affaiblissement économique du pays, dévasté par les guerres du XVIIesiècle (avec la Suède, la Russie, la Turquie, les Cosaques), l’anarchie politique, et une « longue nuit » dans le domaine culturel qui précède les Lumières, venues de France, et qui rayonnent en Pologne dès les années 1740 autour des grands centres comme Varsov
