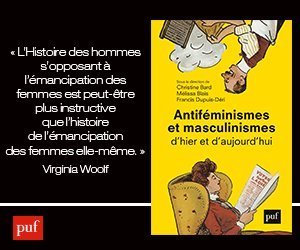La griffe du temps ou l’herméneutique historienne de Judith Lyon-Caen
De plusieurs côtés aujourd’hui, on voit des historiens s’aventurer du côté de la littérature de même que l’on aperçoit des romanciers qui empiètent sur l’histoire, voulant que les « champs » respectifs se rencontrent et s’interpénètrent. Et ceci au grand dam de puristes qui veillent à ce que les chasses respectives continuent à être sévèrement gardées.
Or, le mixage des deux domaines peut se révéler fécond comme le prouve l’essai que vient de donner Judith Lyon-Caen dans La Griffe du temps en partant d’une nouvelle de Barbey d’Aurevilly. Essai audacieux et novateur qui nous est ainsi proposé et qui exige beaucoup de ses lecteurs. Or, que ce soit Barbey, vieux connétable des lettres sentant le moisi et irréductible ultra, qui inspire un tel coup de force est finalement réjouissant. Mais c’est bien grâce à La Vengeance d’une femme, sixième et dernière nouvelle des Diaboliques, que Lyon-Caen apporte ainsi un souffle de fraîcheur méthodologique aux études littéraires via l’histoire.
Certes, c’est de longue date que les historiens se documentent aux sources que peuvent être les œuvres de fiction, romans ou drames. De même, il existe tout un travail d’historien portant sur l’institution littéraire dans ses structures et dans ses développements. Mais, avec l’ouvrage ici présenté, c’est de bien autre chose qu’il s’agit et qui opère sur des recherches plus dialectiques à l’intersection de l’historique et du littéraire. Et, pour donner une première indication à ce propos, disons qu’en ce cas l’analyste interroge au plus près les traces en texte de ce qui renvoie à ces « expériences de vie » qu’ont laissées un auteur, certains transmetteurs des œuvres et, bien évidemment, les personnages de fiction eux-mêmes. Mais commençons par évoquer la nouvelle de Barbey ici en cause et qui, à maints égards, demeure un texte étonnant et riche d’une manière de bravoure.
Nous sommes à Paris à la fin de la Monarchie de Juillet. Un élégant de l’époque, expérimenté en tout domaine,