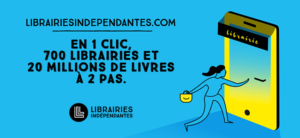Une langue en flammes – à propos de La vie n’est pas une biographie de Pascal Quignard
Ouvrir un livre de Pascal Quignard, fût-il nouveau, c’est toujours entrer dans une œuvre qui est déjà là, qui nous précède autant qu’elle se précède elle-même. Chacun de ses thèmes, de ses motifs ou de ses arguments, s’inscrit désormais dans une écriture au long cours qui déborde largement les cadres qu’elle semble s’imposer et les nouveaux titres qu’elle feint – encore – de décliner.
Qu’y a-t-il, en effet, de si différent entre L’Enfant d’Ingolstadt (Grasset), Angoisse et beauté (Seuil) ou encore Bubbelee (Galilée), tous trois parus l’année dernière et qui évoquent, a priori, des objets éloignés ? Peu de choses, à vrai dire. L’œuvre se reprend sans cesse dans un même geste continué, redéploie ses obsessions structurantes et mise sur un élan créatif, libre de toute frontière générique, qui tâche de rendre sensible le mouvement erratique de la pensée, à travers ses enchaînements imprévus, ses brisures et ses bifurcations. Ainsi, plus le temps passe, plus il semble difficile de vraiment isoler un « nouveau » livre de Pascal Quignard : de tomaison en tomaison, de chapitre en chapitre, de page en page, nous avons l’étrange sensation d’être immédiatement plongés dans la même écriture – à chaque entame de livre, nous sommes toujours, comme à l’ouverture des grandes épopées, in medias res : sans préalable, nous nous retrouvons au milieu d’une séquence qui a déjà commencé depuis longtemps et qui, pourtant, sans cesse recommence.
Ce temps presque immobile de l’œuvre, devenu étale comme une pleine mer, est peut-être ce qui caractérise au mieux l’écriture d’un écrivain, quand celle-ci atteint toute sa mesure. Et quand, à la dynamique évolutive, progressive, elle préfère l’involution en se choisissant pour seul art poétique l’enroulement sur elle-même. C’est là certainement ce qu’il faut comprendre par l’écriture intransitive dont parle Roland Barthes et qui qualifie l’activité d’écrire lorsqu’elle est à soi-même son propre objet. L’œuvre devenue intransitive, c’est