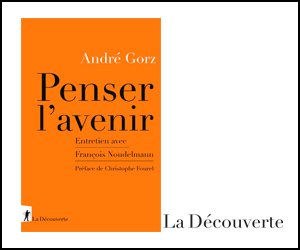Mythifier la violence pour mieux la voir – à propos d’Oreste à Mossoul de Milo Rau
Au départ, il y a Mossoul, cité antique détruite, point géographique et symbolique depuis lequel lire le monde et ses mythes, et non l’inverse. Il s’agit bien ici, dans cette Orestie irakienne, de mythifier le réel, et non de donner corps au mythe. De sorte que c’est « à la manière d’ISIS » qu’Agamemnon étrangle Iphigénie, « façon djihad » qu’Oreste commet son matricide : bourreau derrière, victime à genoux, tête couverte, l’histoire de la violence se raconte au présent chez Milo Rau, à travers ces formes physiques du meurtre – postures et costumes compris – désormais familières dans l’inconscient collectif, que sont les exécutions de Daesh.
Mais qu’allait faire Oreste à Mossoul ? La nouvelle création de Milo Rau cultive, comme à chaque fois, un art de la tension saisissant, par lequel le spectateur se confronte au paradoxe suivant : tandis que la virtuosité de la mise en scène nous plonge dans l’apnée de ses boucles dramaturgiques, nous immergeant dans l’espace scénique comme dans un lieu étanche au dehors, au réel, ce n’est que de ce dernier dont parle Milo Rau : du monde, de l’époque, de son hémorragie de violence. L’irréductible sauvagerie humaine, la substitution de la justice à la vengeance sont les clefs de voûte de cette Orestie irakienne qui, malgré de puissantes images, laisse un ténu sentiment de déception.
C’est l’un des paradoxes du théâtre de Milo Rau : la radicalité de ses sujets, conjuguée à l’habileté technique de sa mise en scène, absorbent le spectateur dans l’espace de la représentation, gangue pourtant inconfortable tant la monstration de l’insoutenable oblige celui-ci à interroger ce qu’il voit, à questionner sa propre pulsion scopique : c’est la force de ce théâtre, dont les images – scéniques comme filmées – engloutissent sans neutraliser, sidèrent sans fasciner. Pas un raclement de gorge, pas un froissement de manches, ce soir-là dans la salle, lorsque Agamemnon, à l’orée du spectacle, raconte le sacrifice de sa fille Iphigénie :