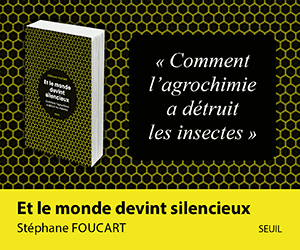La croisée des mondes – à propos de La mer à l’envers de Marie Darrieussecq
On connaît déjà l’histoire : les migrants qui quittent leur pays natal pour franchir la Méditerranée, entassés dans des navires, et dans de terribles conditions, évoquant ces représentations de bateaux d’esclaves qui transportaient des corps contre de l’argent. On connaît l’histoire de ces corps qui paient leur passage de leur propre vie, on a vu les photos des naufrages, des noyés, on a vu le tout petit corps de ce bambin kurde rejeté par la mer, sa peau claire, son t-shirt rouge et son pantalon bleu formant un drapeau tricolore pervers. On a vu les photos des campements du Pas-de-Calais, de la Porte de la Chapelle – impossible de circuler à Paris sans voir les symptômes d’une ville qui ne sait pas accueillir toutes ces vies revendiquant d’accéder au terrain de possibles que leur semble être le sol européen. La crise mondiale s’affiche explicitement dans ces villes qui prétendent que leurs frontières les éloignent et les protègent, d’une quelconque manière, des catastrophes qu’eux, ces autres, ces pauvres, vivent au quotidien.
Nous vivons un moment qui semble avoir tout oublié des leçons douloureusement apprises de la deuxième guerre mondiale, à en croire la remontée fulgurante, partout dans le monde dit démocratique, d’un nationalisme populiste fondé sur une logique xénophobe qui veut que le renouvellement ait lieu par rejet de tout corps étranger, un corps étranger dont l’intrusion fait croître le mythe et la fiction d’un peuple original et enraciné. Nous vivons un moment où un nombre croissant de gens préfèrent tourner le dos à l’extinction imminente de notre espèce pour se plonger dans la nostalgie d’un passé où les frontières étaient solides, où la planète ne se réchauffait pas, où tout était en ordre, chaque chose à sa place, la hiérarchie une fondation immuable. Ces migrants, ces corps et ces vies qui jaillissent là où ils ne devraient pas être sont un choc, une chose qui bloque, qui heurte, qui nous rappelle impitoyablement un ailleurs qu’on voud