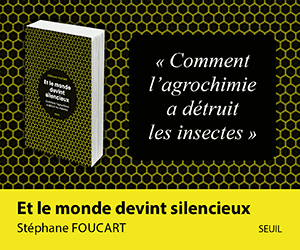Mythologies indochinoises – à propos des Jungles rouges de Jean-Noël Orengo
À l’image d’un des personnages des Jungles rouges, Jean-Noël Orengo pourrait dire de lui que, écrivain de race, il est aussi un « historiophile », un amoureux des histoires, « fait pour les préserver, les entretenir, les transformer ». Son premier roman, La Fleur du Capital, révélait un flâneur-voyeur attaché, à la manière de Katsuya Tomita dans son film Bangkok Nites, à ausculter les nuits chaudes d’une ville de la Thaïlande vouée à la prostitution. Les deux livres sont les deux faces du « Mal jaune », de la tentation de l’Orient qui guette certains voyageurs. Les deux livres sont, pour le premier, le roman de tous les excès, pour le second, une façon de revisiter l’Histoire, l’Histoire avec une grande hache.
En exergue à ses Antimémoires, André Malraux, qui n’apparaît pas à son avantage dans Les Jungles rouges, cite cette phrase d’un texte bouddhique : « L’éléphant est le plus sage de tous les animaux, le seul qui se souvienne de ses vies antérieures ; aussi se tient-il si longtemps tranquille, méditant à leur sujet. » Autant La Fleur du Capital, frénétique rhapsodie des temps présents, joue la partition de la traque perpétuelle sur un rythme où le sexe et l’argent vont de pair comme, chez les romantiques allemands, l’amour et la mort, autant dans Les Jungles rouges, la méditation sur les vies vécues naguère se traduit par cette aspiration à la quiétude : « Se taire est un art, surtout dans une époque aussi bruyante. »
Chez Jean-Noël Orengo, l’Asie a la couleur du sang, le goût de l’artifice et une propension à se créer des légendes.
Au royaume des ombres et du silence, l’effrayant Haut-Parleur, dans un camp érigé par des Khmers rouges, donne le frisson dans les chairs en crachant les ordres de l’organisation révolutionnaire : « Le Haut-Parleur est le grand écrivain universel pratiquant la littérature orale instantanée […] que les détracteurs-espions de la CIA et du KGB appellent bêtement propagande ou complot. » Ces pages, sur les méthodes des séides