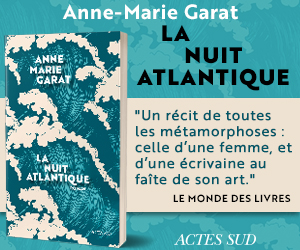Une brèche dans le temps – sur La Peste à Marseille, 1720 de Michelle Porte
Au début du mois d’avril, j’ai retrouvé dans un de mes carnets, en cherchant tout autre chose, une courte note griffonnée au crayon à papier et dans le noir pendant la projection du film La Peste à Marseille, 1720 de Michelle Porte : « Balles de coton, étoffes de Syrie, l’effet d’une mèche allumée se répand à travers les échoppes, les rues, au-delà de la Durance, loin dans les terres ».
Relire cette note a immédiatement suscité l’envie de revoir le film qui m’avait estomaquée cet après-midi-là. La relire au présent d’une situation hors-norme (mais loin d’être sans précédent historique, comme on le sait déjà) m’a fait saisir à quel point le discret film de Michelle Porte, réalisé pour la télévision en 1982 et très peu montré depuis, entrait en collision d’une manière aussi résolue que fracassante avec l’épidémie planétaire de Covid-19.
J’avais entendu parler de Michelle Porte pour la première fois dans un livre de Marguerite Duras, Le Monde extérieur – Outside 2 (P.O.L, 1993), passionnant recueil de textes inspirés par le monde extérieur, justement. Duras y écrit entre autres sur La Palatine à Versailles de Michelle Porte, qui l’a bouleversée. Elle dit que c’est un film qui « … n’est ni sur la Palatine ni sur Versailles, mais [qui est] complètement déplacé. Qui est tragique comme la Tragédie ».
Au fil d’un enchaînement de longs plans séquences ou travellings à travers salles, chambres et jardins du château de Versailles vidé de sa faune royale comme de ses touristes, par une fin d’après-midi de mai noyée dans une lumière opaque, une voix de femme (Geneviève Page) lit en off des extraits de quelques 90 000 lettres envoyées en secret par la princesse autrichienne à ses proches à travers l’Europe. La Palatine, duchesse d’Orléans née Charlotte Elisabeth de Bavière – mariée pour la convenance à un homme qui ne s’intéressait guère aux femmes et par ailleurs frère de Louis XIV – vivait recluse dans un palais des courants d’air où les intrigues étaient légion, la