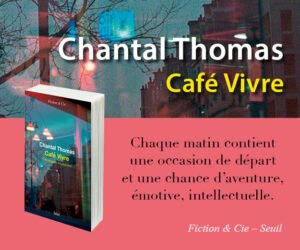Looking for football – à propos de Sunderland ’til I die
Il y a Peter le taxi, Andrew le vétéran d’Afghanistan, Joyce la cuisinière, Marc le prêtre… Les actionnaires et les entraîneurs passent mais eux restent, fidèles et toujours plus désabusés saison après saison. Entre le Sunderland Association Football Club et ses supporters, c’est à la vie à la mort.
Un employé des pompes funèbres locales confie d’ailleurs que la plupart réclament dans leur testament des fleurs rouges et blanches sur leur cercueil quand ce n’est pas carrément le paletot de bois qui se met aux couleurs des Black Cats ! Pour le père Lyden-Smith, qui fait souvent prier ses paroissiens pour leur équipe, « la foi et le football sont étroitement liés à Sunderland. À bien des égards, le stade est une immense église qui unit toutes les religions. »
Mais le culte numéro un dans cet angle mort du Nord-Est de l’Angleterre, c’est sans conteste le ballon rond. « Autrefois, Sunderland était une des capitales mondiales de la construction navale, explique Peter. Nous avions aussi les charbonnages. Il nous ne reste plus que le football. » Le dernier chantier a fermé en 1988, la dernière mine en 1994. Chômage, pauvreté, maisons miteuses en séries, Sunderland, 175 000 habitants, n’a pas eu la chance de sa grande voisine Newcastle, distante d’à peine vingt kilomètres mais qui semble s’être accaparé tous les subsides de la requalification post-thatchérisme.
« Mais c’est comme une relation toxique, lâche une jeune femme à la sortie d’un match. Le mec n’arrête pas de te tromper et pourtant tu restes avec lui ! »
Le seul luxe de Sunderland, c’est son stade de 48 707 places, le Stadium of Light, qui ferait le bonheur de beaucoup de clubs. Peter, comme Andrew et des milliers d’autres, y a son siège à l’année depuis toujours. Il est ce qu’on appelle de l’autre côté du Channel, un season ticket holder, un abonné.
Mais les fans des Blacks Cats ne se contentent pas d’assister aux matches à domicile, ils comptent parmi les plus grands voyageurs du royaume, passant leurs