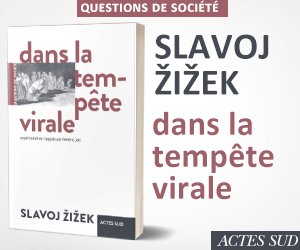La Marmite ou comment rendre à la collectivité ce qui vient d’elle
Dans son récit autobiographique My life, Isadora Duncan évoque brièvement son séjour à La Havane en racontant une soirée dans un bar enfumé de la vieille ville. Un homme étrange joue soudain des Préludes de Chopin : « Je l’écoutais quelque temps, puis m’approchai de lui mais il ne put me dire que quelques mots incohérents. Sachant que j’étais ici complètement inconnue, il me vint le désir fantastique de danser pour cet étrange public […]. Je continuai à danser jusqu’au petit matin et quand je repartis, ils m’embrassèrent tous ; je me sentis plus fière que dans aucun théâtre, car j’avais trouvé la preuve de mon talent ; nul impresario, nul article de journal n’avait préparé l’attention du public. »
Les mots d’Isadora semblent répondre simplement à une problématique noueuse : une œuvre a-t-elle besoin d’être décryptée, prémâchée avant de rencontrer un public ? Faut-il ajouter un intermédiaire pour que le spectateur puisse se laisser atteindre ? Si, dans son ouvrage paru au Seuil en 2019, Esthétique de la rencontre, Baptiste Morizot détaillait les multiples raisons d’une non ou d’une fausse rencontre avec l’œuvre, il tentait également quelques solutions en prônant les exemples des œuvres collaboratives qui incluent le public dans la conception/fabrication même de l’œuvre. Il faudrait donc être impliqué pour être intéressé, faire partie du procès pour être ému.
« La culture n’est pas une condescendance de la charité ; il s’agit de rendre à la collectivité ce qui vient d’elle. »
Dans ma conception du métier de critique, il me parait inopportun de m’interroger sur la réception d’une œuvre que je dois analyser et dont je souhaite rendre compte. La réaction et l’adhésion du public, la densité des applaudissements ou les commentaires précédents ou suivants la rencontre n’entrent pas dans mon champ de réflexion tant je souhaite que les créateurs oublient le spectateur dans la maturation de leur travail et créent pour répondre à une urgence, à une nécessité, à une i