Entrelacements – sur Sages femmes de Marie Richeux
Il faudrait pouvoir parler de Sages femmes, le quatrième livre de Marie Richeux aux éditions Sabine Wespieser — et troisième dont la narratrice a pour prénom Marie — sans rien en dévoiler. Une gageure. Car se plonger dans ce pudique roman d’une grande intensité, et que pendant toute la lecture l’on pourrait prendre pour un récit, demande à n’avoir aucune idée de ce qu’il recèle. Une boîte à merveilles comme l’étaient certaines boîtes à couture, comme le sont encore certains albums photographiques ou registres d’archives.
Mais en tentant de ne rien en dévoiler, par quel bout le prendre, qu’en livrer sans le trahir, sur quel fil tirer pour que l’ouvrage se détisse de lui-même, comme s’y obstinait Pénélope dont le geste chaque fois réitéré pourrait être la métaphore de tant de vies non consignées ? Tant de femmes ayant parcouru ou parcourant leur temps en toute discrétion, menus travaux et labeur acharné, silences obligés et donneuses de vie à des nouveau-nés – ici de nouvelle-nées illégitimes qu’elles choisiront de garder – pour qu’en grandissant, ces petits êtres tissent à leur tour une toile discrète dans un monde d’hommes, toiles ouvragées aussi fragiles que celles, admirables, des araignées.
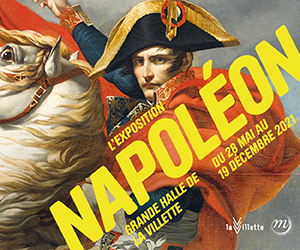
Tout commence au croisement de trois routes : trois possibilités dictées par une figure impassible (une statue de la Vierge), à un personnage féminin nommé Marie également et l’on comprendra que ce n’est pas tout à fait un hasard. La porosité de la narratrice à l’incertitude du monde, de son corps à la lumière, aux courants telluriques, aux sons, aux orages, est d’emblée saisissante. Elle se tient là avec sa petite fille qui, tout au long du livre, entraînera sa mère dans la réalité parallèle de ses interrogations (« Qu’est-ce qui finit ? » ; « Rabattre la toile pour pas entendre quoi maman ? Pour pas entendre l’orage ? ») pour lui faire tantôt perdre pied, tantôt revenir brusquement au réel. Et que dire de ses propres rêves, fabuleux, prémonitoires, qui parfois eux
