Un réseau d’amitié et de souvenirs – sur Nous étions l’avenir et Elle était une fois de Yaël Neeman
En 2015, par la traduction de Nous étions l’avenir chez Actes Sud, on a pu découvrir une nouvelle autrice israélienne, Yaël Neeman. On peut se réjouir que progressivement l’intérêt pour la littérature de ce pays soit moins focalisé sur le discours politiquement rassurant de quelques auteurs phares comme Amoz Oz ou David Grossman et qu’il s’ouvre sur l’entièreté de sa création littéraire. En 2008, le salon du livre invitait Israël et la polémique qui s’ensuivit n’a pas contribué à faciliter les choses. Cette ouverture est plutôt le résultat d’un travail de fond de traduction, porté par différents éditeurs mais en particulier par les éditions Actes Sud et l’opiniâtreté de la traductrice et éditrice Rosie Pinhas-Delpuech.
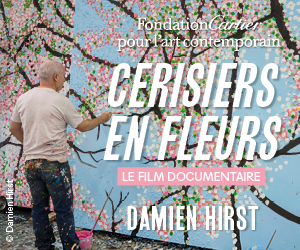
Pour parler de Yaël Neeman, j’ai voulu inclure dans ce texte, qui dépasse le cadre d’une recension, son précédent ouvrage traduit en 2015. Ce que je voudrais faire apparaître ici, c’est la forme à mon avis originale d’une quête identitaire qui prend en compte l’Histoire comme un magister vitae, et qui se tient au bord de l’auto-fiction comme sur le pas d’une porte, attentive à ce que la substance du moi a d’inconsistant, c’est-à-dire en quoi elle est une question plus qu’une réponse, et de quelle façon elle ne signifie quelque chose qu’en fonction d’un échange avec autrui, d’une variation infime d’un élément (comme une lettre change le sens d’un mot).
La variation autour du rire de Pazith, héroïne de Elle était une fois, en est le paradigme : tous ceux qui l’ont connue se souviennent de son rire mais le racontent un peu différemment. Cette variation de l’un à l’autre, même infime, et justement parce qu’elle est infime, illustre une conception du moi qui ne démentit pas la théorie saussurienne : nous différons, très peu, parfois beaucoup, les uns des autres, et Yaël Neeman travaille à passer de l’identité narrative centrée sur un moi ombilical (auquel elle reconnaît une valeur essentielle, attentive qu’elle est au confort ou à l’inconfort d’ê
