Demeures et soi – sur État des lieux de Deborah Levy
Déborah Lévy est née en 1959 à Johannesbourg, soit dix ans après la publication du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. En 1968, sa famille s’installe à Londres, la petite fille quitte le soleil d’Afrique du Sud et la terre où son père fut prisonnier politique plusieurs années durant. Elle a 54 ans, en 2013, lorsque paraît le premier volet de sa trilogie dite « autobiographie en mouvement ». Romans, nouvelles, poèmes et pièces de théâtre l’ont déjà révélée au public anglophone.
Le dernier volume de ce projet traduit en français par Céline Leroy pour les éditions du sous-sol a paru cet automne, il s’appelle État des lieux. Les précédents opus auxquels il est trop tentant de se référer (même s’il se lisent dans n’importe quel ordre) portaient déjà deux merveilleux titres : Le coût de la vie et Ce que je ne veux pas savoir. Deborah Levy dit qu’il y a, contenu dans ces trois ouvrages, vingt ans d’expérience féminine. Ils commencent lorsque ses filles sont très jeunes et se terminent lorsqu’elles ont quitté la maison. « Avec ces livres, j’espère avoir emmené un personnage féminin et toutes ses turbulences au centre du monde, en donnant leur pleine valeur à ses réflexions. »
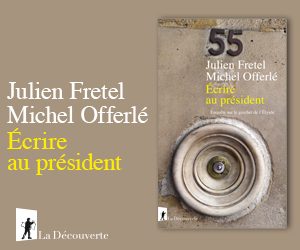
Si l’on évoque d’emblée l’âge de l’autrice, c’est qu’elle en fait de même et qu’elle en fait un sujet. Aux deux sens du terme. « C’est épuisant de devenir un sujet » disait déjà la narratrice dans un précédent opus, « mais c’est une bonne fatigue ! » était-on tenté de lui répondre en lisant.
Une femme comme sujet, devenant personnage principal de son propre récit, cette pensée continue d’être creusée sans relâche, et se double ici d’une mise en abyme, puisque la narratrice s’obstine à l’écriture d’un scénario. Autour d’un café, un jour qu’elle arrive en retard avec des feuilles d’arbre dans les cheveux, une productrice cruelle lui demande : comment le public est censé s’attacher à un personnage de femme vieillissante, impitoyable sur sa vocation, en prise avec des désirs et des conflits qui
