Dealeuse par bonté – sur Neige de Juliet Berto et Jean-Henri Roger
Au commencement, il y a quelques notes de basse. Une caméra flotte devant un pan de mur bleu, un piano vert, deux musiciens qui répètent sur scène. Le mur est d’un bleu étoilé, brillant, électrique comme celui du générique. « Il y a ce bleu », dit d’ailleurs la voix off d’une femme, « ce bleu qui fait tout basculer. » C’est Juliet Berto : le grain perlé de sa voix accompagne les mouvements de la caméra intranquille. « Bleu », reprend-elle, « comme les veines que Bobby remplit d’un liquide blanc, blanc et vide, comme le regard que je fixe sur ce môme que j’ai élevé et qui continue à me filer entre les doigts, ses yeux rivés sur les îles lointaines. »
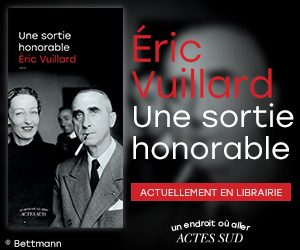
Le même plan inquiet se poursuit, hésitant, et dévoile avec ses déambulations les recoins du bar la Vielleuse. La caméra s’immobilise seulement devant elle, Berto, souriante derrière le comptoir en zinc. Elle incarne Anita, la barmaid qui s’agite, toujours chaussée de ses bottines noires, emmitouflée dans un manteau en fausse fourrure. Anita veut d’abord protéger un gamin devenu dealer, ce gamin qu’elle sent être le sien, par une sorte d’entêtement, ou de filiation sans sang, une maternité imaginaire et noble, maladroite et insuffisante. Le garçon a mal tourné, alors elle se sent responsable, comme si elle devait rattraper les inégalités ou les mirages d’un quartier mixte, populaire et, souvent, explosif.
Tout ce bleu, donc, comme le ciel des îles lointaines qu’on ne voit jamais, et du blanc, le carrelage des toilettes ou plutôt le néant de la dope. Tout ce blanc, en fin de compte, pour parler des liens fragiles, inespérés, au sein d’une nébuleuse à la dérive dans une partie bien précise du nord parisien. « Barbès me nargue. Le quartier où j’habite, il est vital que j’en parle » : Neige est, selon Juliet Berto, une balade entre Barbès et la Place Blanche.
Neige découvre la typologie d’un quartier transfiguré où se nichent désormais les recalés des Trente Glorieuses.
« Sur le Boulevard, les forains se sont insta
