Debout l’humour ! – à propos de la série Drôle
Le jeudi 12 mai 2022, Netflix rendait publique sa décision de ne pas reconduire pour une deuxième saison sa dernière production française, Drôle. Malgré l’immense succès critique, malgré l’enthousiasme impressionnant des spectateurs. En cause, des chiffres d’audience gardés confidentiels mais jugés insuffisants au regard de ce que la plateforme espérait. Cette décision, prise après seulement trois semaines de mise en ligne, a de quoi surprendre. L’argument avancé aussi, tant il semble irréaliste de demander à une série de trouver son public en si peu de temps, surtout s’agissant d’un pari aussi audacieux : combiner série populaire et œuvre d’auteur, loin des attentes et des clichés.
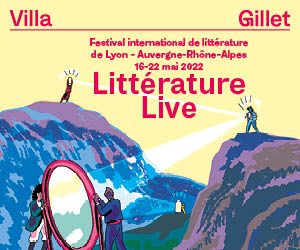
Une première façon de pitcher Drôle serait de dire que la série, dont l’action se déroule principalement sur une petite scène parisienne, le Drôle Comedy Club, suit le parcours de quatre jeunes stand-uppeurs qui tentent de percer dans le métier. On les accompagne dans leurs aventures entre quête de reconnaissance, débrouille et travail acharné pour polir un art de la vanne dont la série fait comprendre combien il est exigeant et fragile.
Il y a Nézir, livreur autoentrepreneur qui vit avec son père algérien handicapé et au chômage. Sa force, c’est sa plume subtile et son charme discret d’anti-mâle alpha. Il y a aussi Aïssatou, jeune mère de famille pêchue qui a pour elle son énergie, son smile et son franc-parler. Un sketch audacieux sur le plaisir prostatique qui devient viral va accélérer brutalement sa carrière et la propulser sur le devant de la scène, devant Bling. Propriétaire du club, celui-ci a connu la gloire quelques années plus tôt, et les excès qui vont souvent avec. Depuis, l’ancien mentor de Nézir et Aïssatou galère pour retrouver le succès et surtout le sens de ce qu’il fait. Il y a enfin une nouvelle arrivante, Apolline, que l’on voit d’abord au Drôle comme spectatrice – disons même comme fan. Il faut dire que le stand-up est pour cette fille de (très) bonne fami
