Sauver la trace –
sur « Humpty/Dumpty » de Cyprien Gaillard
Les ruines sont à la mode. Comme tout ce qui explore le motif de l’effondrement et de ce qui lui résiste : arts plastiques, cinéma, séries, pratiques de l’exploration urbaine – jusqu’au ruin porn. Se développe depuis quelques années une esthétique dont l’artiste français Cyprien Gaillard est sans doute l’un des représentants les plus emblématiques et les plus doués.
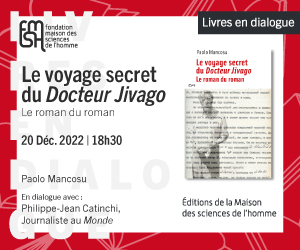
On pourrait l’appeler post-apocalyptique ou soft-apocalyptique, car c’est sous l’horizon d’une fin du monde qu’elle se situe et s’installe : héritière du romantisme, elle se laisse fasciner par le déclin et les phénomènes de destruction ; à la recherche d’un pittoresque postindustriel, elle exprime une forme de détresse face à un futur inéluctablement catastrophique ; c’est un art certes mélancolique – qui nous fait voir le présent et le futur sous un angle archéologique : comme s’ils étaient déjà morts et ensevelis –, mais qui n’en demeure pas moins séduisant et pop (on pourrait parler de pop archéologie, comme il y a une pop philosophie).
Cyprien Gaillard s’inscrit dans cette esthétique rudérale. Avec Humpty\Dumpty – titre de l’exposition en deux volets et, à l’origine, personnage d’œuf qui, une fois tombé, ne peut retrouver son état originel – l’assemblage de vidéos, photos, installations, ready made de l’artiste – et de ceux qu’il expose – ne cesse là encore de souligner une chose : comme le personnage ovoïde irréversiblement abîmé par sa chute, les êtres, les choses, les œuvres, la nature subissent altérations, modifications et destructions, celles du temps comme celles de l’homme, y compris lorsque celui-ci cherche au contraire à les préserver, à les conserver et à les restaurer.
Le ton est donné dès l’entrée de l’exposition au Palais de Tokyo : à même le sol, de gros sacs de chantier contiennent les cadenas que des milliers de couples de touristes avaient accrochés aux grilles du Pont des arts pour sceller leur amour. Ces love locks devaient symboliser l’indéfectibilité d’un lien ; ils o
