Œuvre et document – sur « Renverser ses yeux : autour de l’arte povera »
Pour Germano Celant, son idéologue et inventeur, l’arte povera naît, à l’occasion de sa première exposition à Gênes en 1967, moins en réaction au pop art d’un Andy Warhol qu’au minimal art d’un Donald Judd ou d’un Frank Stella. Les trois mouvements partagent pourtant un point de départ commun : une situation de saturation de l’histoire de l’art. Tous les trois expriment « le refus de confier au transcendant et à la cité céleste que sont peinture et sculpture la solution des contradictions de l’existence » (Germano Celant, dans Arte povera, Electa, 1985).
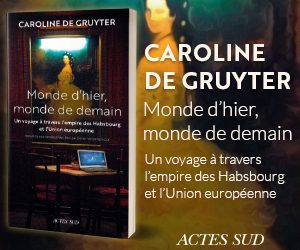
Le pop art choisit la voie d’une célébration de l’éphémère qu’est la marchandise et de l’hédonisme de la société de consommation. Le minimal art, l’essentialité puritaine de la ligne droite et du cube, qui ne prend tout son sens que dans un nouveau-monde quelque peu oublieux de l’histoire. Face à eux, l’arte povera naît en Italie, le pays peut-être le plus surdéterminé, voire écrasé, par son passé artistique : la tabula rasa n’est pas une option pour les artistes italiens. L’hédonisme consumériste non plus, dans le pays le plus communiste d’Europe de l’Ouest, qui plus est dans une décennie – les années 1960 – d’effervescence insurrectionnelle.
L’arte povera a pourtant ceci de commun avec l’art minimal, qu’il s’en remet à l’essentiel et au simple. Mais il en diffère dans la mesure où l’essentiel est moins cherché dans les formes, que dans les idées. Union de l’art et de la vie, indistinction de l’artiste et de l’individu, convertibilité de l’œuvre et de l’action, totale liberté de création, alchimie des matériaux contraires. Voici en quelque sorte l’unité idéologique et éthique de l’arte povera, qui, pour les registres de l’histoire de l’art, apparaît comme un mouvement éclaté : lancé par le critique d’art Germano Celant à la fin des années 1960, il trouve son précurseur chez Piero Manzoni presque une décennie plus tôt (auquel on peut ajouter, plus lointainement, pour leur travail des matériaux, Alberto Bur
