Le jardinier mis à nu par ses prétendantes – sur Master Gardener de Paul Schrader
À 26 ans à peine, en 1972, le jeune critique Paul Schrader publiait son premier et unique essai, chant d’amour à un cinéma spiritualiste épuré bien éloigné des canons du story-telling qui lui avaient été enseignés à UCLA. Le style transcendantal au cinéma : Ozu, Bresson, Dreyer a paru en décembre dernier pour la première fois en traduction française.
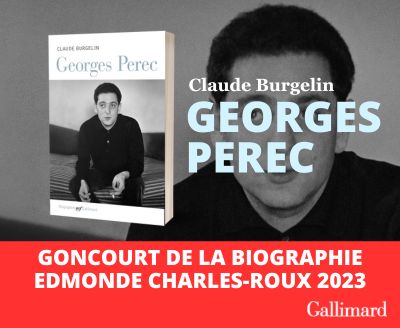
Avant le travail des éditions Circé, il fallait le découvrir en VO pour évaluer l’écart entre l’amour du réalisateur pour ses grands maîtres et son cinéma mené à tombeau ouvert. Le jeune homme y développait un point de vue très américain sur des cinéastes intellectuels et leur art à toucher par leurs images quelque chose de l’ordre de l’invisible et de l’indicible.
Si la Nouvelle Vague a fait de l’exercice critique un vestiaire d’échauffement pour une pensée de la mise en scène, il est en revanche rarissime, dans l’écosystème hollywoodien, de passer de l’un à l’autre. Enfant de ce Nouvel Hollywood dont Paul Schrader a été le scénariste emblématique, Quentin Tarantino fait lui le chemin inverse : de la réalisation à l’écriture critique avec son essai Cinema Speculations, il dessine des chemins de traverse, alternative à l’histoire plus majoritaire écrite par « l’industrie ».
Héros métaphysique
Schrader a toujours estimé que le modèle d’un cinéma de la soustraction qu’il chérissait, s’appuyant sur le geste plutôt que sur l’action, sur le cadre et l’esthétique plutôt que sur le story-telling, était impossible dans le giron d’un cinéma hollywoodien porté par une vision commerciale des films. En plein retour de reconnaissance après la disgrâce de Dog Eat Dog, Schrader signe avec Master Gardener ce qu’il désigne comme la fin d’une trilogie thématique dans laquelle il se mesure frontalement à ses maîtres.
Son premier volet, First Reformed était une reprise contemporaine du Journal d’un curé de campagne de Bresson dont le prêtre joué par Ethan Hawke serait un proche cousin du Travis Bickle de Taxi Driver hanté par l’A
