L’attente – sur Welfare de Frederick Wiseman
Cheveux noirs et courts, fins sourcils, joues rondes encore arrondies par un sourire pincé. Un visage apparaît, qui pourrait être celui d’une héroïne de John Cassavetes. Puis un autre : homme blanc, yeux agrandis par des lunettes, grisonnant. Et un autre : femme noire, épaisses boucles luisantes s’échappant d’une casquette. Et un autre. Un flash les éblouit brièvement, avant qu’il ne cède la place.
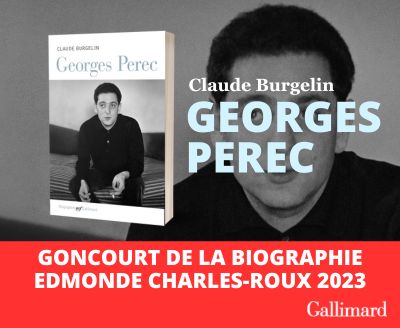
Welfare débute ainsi, par une série de portraits. Placée à proximité de l’imposant Polaroïd que manipule une employée du Centre d’aide sociale de Waverly (New York), la caméra redouble alors moins la procédure administrative qu’elle n’en expose le déroulé machinal. Les formules se répètent, les individus défilent. À la différence également de la photographie, le film ne fabrique pas un document d’identification censément neutre, mais capte ce qui traverse les visages – la concentration, l’agacement, la lassitude, parfois une légère absence à soi.
Comme auparavant dans un asile psychiatrique (Titicut Follies, 1967), un lycée (High School,1968), un centre d’entraînement militaire (Basic Training, 1970) ou un tribunal pour mineurs (Juvenile Court, 1973), Frederick Wiseman et son chef-opérateur se situent avec Welfare dans un lieu qui, par métonymie, devient la figure d’une institution. La méthode est invariable : une fois obtenue l’autorisation d’enregistrer librement, et après une très brève période de repérages, un tournage de six à huit semaines débute, durant lequel Wiseman s’occupe du son et par là même oriente les prises de vues, en l’occurrence assurées par William Brayne. Pour fatigué qu’il soit, le terme « immersion » est certainement celui qui convient le mieux à une approche se refusant aux étayages discursifs, commentaires ou entretiens, et réduisant au minimum l’exposition (ici, une file d’usagers piétinant dans un petit matin froid filmée depuis le trottoir face à l’agence). Au terme d’un montage qui dure entre six et douze mois, chaque microcosme rév
