Renverser Wagner – sur Lohengrin mis en scène par Kirill Serebrennikov
Mettre en scène un opéra de Richard Wagner n’est jamais strictement une affaire de mise en scène. Il ne s’agit pas seulement de se différencier d’autres Lohengrin et d’autres Ring – et notamment de ceux que l’on monta entre 1930 et 1945 –, mais aussi de se positionner vis-à-vis de Wagner lui-même, ses opinions politiques, son antisémitisme, son rapport complexe à la religion, aux femmes, etc. La présence du compositeur dans son œuvre est telle qu’il est impossible de l’ignorer complètement.
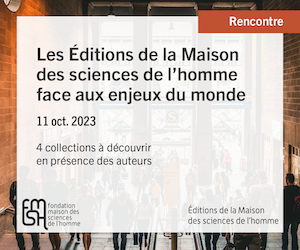
Choisir de mettre ces questions de côté, comme c’est le cas dans les productions qui entendent s’en tenir à la littéralité du livret, n’est qu’une manière de prendre position sans le dire. Difficile de comprendre le personnage de Lohengrin si l’on ne sait rien de la situation de l’Allemagne dans les années 1840 et de l’engagement de Wagner auprès des révolutionnaires européens et des militants anarchistes – qui l’obligea, après l’insurrection avortée de Dresde, à s’exiler en Suisse. Un des intérêts de la mise en scène de Kirill Serebrennikov est d’aborder ces questions frontalement, et de rendre sensible certaines des contradictions qu’elles recouvrent.
En simplifiant beaucoup, nous dirions qu’il existe trois manières de mettre en scène Wagner, trois grands types d’incarnation scénique de ses opéras : 1) le type conservateur, qui est le plus souvent historicisant et naturaliste (ou hyper-romantique avec Werner Herzog en 1987), mais qui sait aussi être kitsch ou baroque (comme chez Elijah Moshinsky et August Everding dans les années 1970), 2) le type symbolique et/ou allégorique, qui peut être abstrait (Wieland Wagner en 1958, Bob Wilson en 1998), matiériste (Romeo Castellucci dans son Parsifal) ou didactique (Hans Neuenfels en 2011 dans un étrange Lohengrin dit « des rats »), 3) le type iconoclaste, qui, sous couvert d’esthétiques très variées, entreprend de réécrire le drame, subvertissant tout ce qui pourrait rattacher l’œuvre de Wagner à l’imagerie germanique du prem
