Barbe à papa – sur Rosalie de Stéphanie Di Giusto
Le personnage de Rosalie Deluc (Nadia Tereszkiewicz), s’inspire de Clémentine Delait (1865-1939), entrée dans la postérité comme la femme à barbe de Thaon-les-Vosges.
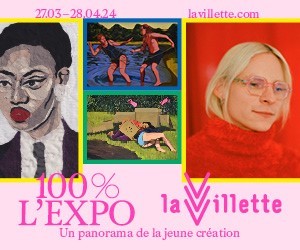
Relevant un jour le défi d’un client de son café, celle-ci se laisse pousser la barbe qu’auparavant elle prenait soin de raser, ce qui lui vaut une certaine célébrité locale. Les retombées économiques sur le café (rebaptisé « le Café de la Femme à barbe ») se font sentir, et elle commercialise elle-même un grand nombre de cartes postales à son effigie.
C’est de cette trame biographique que part Stéphanie Di Giusto pour développer sa fiction : comme l’indique le nom même de son héroïne, à la fois transparent et autre (Delait/Deluc), le film n’est pas un biopic, et si l’histoire nous rappelle quelque chose, on la reconnaît comme à travers un miroir déformant de fête foraine. La femme à barbe historique et son reflet ont quelques points communs : ce fameux défi relevé, le café devenu populaire, la vente de cartes postales. En outre, le refus de s’exhiber en tant que phénomène humain (ce que contrairement à son double fictif, Clémentine fera tout de même occasionnellement à la fin de sa vie), la santé précaire du mari, le désir d’adopter une petite fille (Rosalie en sera empêchée, pas Clémentine). C’est à peu près tout.
Les autres intrigues que développe la réalisatrice à partir de ces éléments biographiques sont donc d’autant plus significatives qu’elles ne se fondent sur aucune réalité historique. À commencer par celle qui structure entièrement le film, des premières scènes au final pathétique : la longue épopée d’Abel (Benoît Magimel) pour changer de regard sur sa femme, dont la pilosité le répugne et dont la barbe, arborée fièrement, l’humilie. Ce dégoût, surmonté in extremis mais qui nous est présenté comme tout naturel, et avec lequel nous sommes vraisemblablement invités à sympathiser, fait écho au rejet de Rosalie par l’ensemble des villageois, influencés par le machiavélique patron (Benjamin Biolay) qui a la mainmise sur tout le bourg et voit d’un mauvais œil le succès soudain du Café de la Femme à barbe ; il interdit à ses ouvriers de s’y rendre et, par l’intermédiaire d’un curé, incarnation de la bigoterie locale, l’accuse de tous les maux qui frappent la communauté (notamment après un incendie dans l’usine, causé par l’inadvertance d’une ouvrière qu’on a vue se promener avec Rosalie).
Dans la partie de chasse à courre qui ouvre le film, un grand cerf est mis à mort et la curée jetée aux chiens, la meute se déchaîne ; de même, les villageois harcèlent, insultent, violentent Rosalie. Comme l’écrit la réalisatrice dans le dossier de presse « à l’arrière-plan de cette histoire d’amour, il est question de la nature de l’homme à vouloir détruire l’autre, quand il est différent. »
Cette idée d’une nature humaine violente, dont le premier réflexe est de ridiculiser ou d’anéantir le monstre (c’est-à-dire l’être qui excède radicalement les normes admises) évoque des précédents cinématographiques : la scène de la gare dans Elephant Man où Joseph Merrick est cerné, déshumanisé par la foule (« I am not an animal! »), ou cette autre foule, dans Frankenstein, qui se lance, armée de torches, à la poursuite du monstre. Mais, d’après les traces qui nous en restent, l’existence de Clémentine Delait ne correspond aucunement à ces images. Dans ses Mémoires de la femme à barbe (1934), elle témoigne : « Ce que j’avais craint, surtout, en me montrant, c’étaient les moqueries de mes compatriotes. Ceux-ci, au contraire, semblaient plutôt fiers de moi. Ils éprouvaient du plaisir à dire aux étrangers : – Elle est de chez nous, nous la connaissons depuis son enfance. […] Mon mari, le premier, était heureux de mon succès : – Venez voir ma femme, disait-il à qui pouvait l’entendre. »
La représentation d’un milieu caricaturalement intolérant et répressif sert un récit de libération trop facile : face à toutes ces brutes, on ne peut qu’admirer la flamboyance de celle qui s’émancipe, quand bien même ce ne serait que sur le mode du développement personnel. En réalité, si une poignée de scènes montrent bien l’émancipation de Rosalie, qui se libère des disciplines corporelles que son père lui imposait (notamment le rasage quotidien), assume cette nouvelle apparence dans le village interloqué, découvre le plaisir sexuel (en se masturbant dans la forêt : une façon de se connecter à son « féminin sacré » ?), et met en scène son corps comme elle l’entend pour des photographies, ce parcours de libération est très vite rabattu sur des intrigues de conjugalité et de filiation. Malgré son anormalité physique, ce que le personnage désire avant tout, c’est la norme hétéropatriarcale : être acceptée par son mari, devenir mère. Dans cette logique, on remarque que le fait de susciter un regard masculin désirant (particulièrement chez son mari, mais aussi chez les autres hommes) est un enjeu important pour Rosalie, ce qui la pousse notamment à poser en corset, selon des codes représentationnels plus proches des photos de pin-ups que de freaks.
« Qu’est-ce que le désir pour une femme comme elle ? Et encore plus fascinant : une femme comme elle est-elle désirable ? » s’interroge la réalisatrice dans sa note d’intention. Une question d’autant plus insolite en l’occurrence qu’à part la pilosité prononcée qu’elle arbore, l’actrice choisie pour le rôle est parfaitement conforme à toutes les normes de beauté imaginables (pour n’en citer qu’une, la minceur, alors que Clémentine Delait a toujours été une femme forte). On a un peu du mal, dès lors, à sympathiser avec le calvaire d’un mari (« [J’espérais] que vous soyez comme les autres ! ») qui a visiblement le double de son âge.
On regrette aussi que cette question du désir ne soit envisagée que par un prisme strictement hétérosexuel, quand un trouble queer traverse certaines pages des Mémoires de Clémentine Delait. Elle évoque par exemple une vendeuse qui, la prenant pour un homme, « minaudait, faisait la belle », ce qui l’amuse beaucoup. « En la quittant, je lui serrai la main, et elle rougit. Sans doute attendait-elle mieux… » Ces moments fugitifs n’ont en soi rien de révolutionnaire, et comme le rappelle Christine Bard dans Mon genre d’histoire, Clémentine Delait n’a jamais été perçue comme une menace. « En 1901, elle commença à laisser pousser sa barbe, prit le costume masculin et vendit son image. Respectant ses devoirs familiaux, munie de l’autorisation suprême du ministre de l’Intérieur, elle ne menaçait pas l’ordre social. Elle restait socialement une femme, une femme différente des autres, fière de sa barbe. » Mais même ce travestissement autorisé brille par son absence dans le film.
L’émancipation de Rosalie se fait dans l’acceptation passionnée plutôt que dans la remise en cause du système patriarcal.
Il est surtout dommage que la barbe, le trouble dans le genre qu’elle induit, la figure même de Clémentine Delait, ne soient finalement que des prétextes à s’attarder sur « la petite affaire privée » du personnage, sa relation œdipienne à son père, puis à son mari, son désir d’enfant, alors qu’une telle histoire aurait pu permettre d’explorer des questions plus vastes, ouvertes sur le monde, notamment autour de la présentation, la spectacularisation, l’exploitation de cette particularité physique. Le problème est rapidement évacué dans le film. « Il y a beaucoup de gens idiots, explique Rosalie à un journaliste, ils ne comprennent pas pourquoi je ne me cache pas. Ils préféreraient me voir dans une foire, j’imagine, ou dans une grotte au fond de la forêt. » La foire, apanage des idiots, est synonyme de déchéance absolue, presque impensable.
En interview, Stéphanie Di Giusto insiste souvent sur le fait que son héroïne refuse de devenir un « vulgaire », un « banal » phénomène de foire. Cette vision univoque de cette pratique sociale empêche la réalisatrice d’interroger véritablement la position paradoxale de son héroïne, habitée par une volonté de distinction par rapport aux autres phénomènes humains, mais qui exploite (certes dans l’espace de son café plutôt que de la foire) la même curiosité pour les corps hors normes que les freaks qui lui sont contemporains. Ainsi la vente de cartes postales était-elle une pratique extrêmement courante dans les freak shows.
Et si Clémentine Delait elle-même tenait à se distinguer des femmes à barbe exposées dans les foires, notamment parce qu’elles ne lui semblaient pas très convaincantes (« La femme à barbe de Barnum ! Une pauvresse qui se traîne, une loque ! Et quelle misérable barbe ! »), elle se montre dans ses Mémoires admirative de certaines de ses « collègues », notamment une personne de petite taille, « un vrai bijou de quarante centimètres, de formes parfaites, mais dont la peau ressemblait à celle d’une panthère », qui était montrée dans le cirque Barnum à Épinal et qu’elle amène avec elle à Thaon, pour qu’on puisse venir la voir dans son café. Elle évoque aussi une « femme-tronc », exhibée avec elle à Luna-Park. « Son visage était joli et elle m’était très sympathique. Je dus un jour la défendre contre les impertinences d’un visiteur. »
Dans le film, l’émancipation du personnage n’a pas de sens collectif, elle ne peut se faire qu’envers et contre tous, dans l’acceptation passionnée plutôt que dans la remise en cause du système patriarcal, une conviction qui rapproche le film d’une autre histoire de « femme puissante » présentée à Cannes au même moment, Jeanne du Barry de Maïwenn. Là aussi une femme hors du commun, libre et haïe en raison de sa liberté, s’affranchit seule d’un milieu imbécile qui ne la comprend pas pour s’accomplir dans une histoire d’amour dont le caractère romanesque peine à dissimuler la structure fondamentalement inégalitaire. Ces deux films matérialisent les limites de la notion de « female gaze » comme outil critique : s’ils sont en effet réalisés par des femmes, suivent des personnages féminins, donnent à voir ou à vivre des expériences de femmes, ils ne remettent nullement en cause le « male gaze » entendu comme « le régime scopique capitaliste qui prédomine, inhérent au système qui simultanément l’engendre et le soutient »[1].
Alors que le cinéma français connaît d’importantes mutations, que son esthétique et ses modes de production sont interrogés en profondeur par des personnalités telles que Judith Godrèche, Aïssa Maïga, Adèle Haenel ou les membres de l’Association des Acteur.ices, il est important de ne plus se contenter de gimmicks (retracer le destin de femmes « oubliées », « pionnières »[2], « puissantes », « inspirantes », ou autres « girlbosses ») et de réaliser l’importance non seulement de raconter des récits de femmes et de personnes minorisées, mais surtout de la façon dont on les raconte.
Un film qui retrace l’existence d’une femme du passé, réelle ou fictive, peut replacer cette existence dans les rapports sociaux de son époque, envisager la dialectique entre la volonté du personnage et les limites qu’on lui impose (y compris dans les films les plus intimistes : dans Portrait de la jeune fille en feu, cela passe par les vêtements lourds et sans poches d’Héloïse, la vigilance maternelle qui restreint ses mouvements, son accès limité à la musique et à la littérature), bref, même en filigrane, faire une place au collectif. Ou bien cette époque peut n’être qu’un décor pittoresque pour un récit finalement anhistorique, celle d’une femme not like other girls, plus intelligente, plus belle, plus courageuse que les autres. Alors, qu’il s’agisse d’un village français ou de la cour de Versailles, ce n’est plus que la toile de fond d’une apothéose individualiste, le ciel obscur où passe une étoile filante.
« J’ai toujours agi en individu ne songeant pas à fonder une société ou à bouleverser celle qui existait. J’aime, par-dessus tout, la logique et si je consens à être une exception (on ne peut pas faire autrement dans certains cas) je n’entends pas la confirmer en prenant mes personnelles erreurs pour de nouveaux dogmes », écrivait Rachilde dans Pourquoi je ne suis pas féministe (1928), texte par ailleurs complexe et paradoxal. À force de se penser comme un être à part, un phénomène unique, une exception, c’est surtout la règle qu’on risque de confirmer.
Rosalie, un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, sortie en salles prévue le 10 avril 2024.
