Déprise de vue – sur In Water de Hong Sangsoo
D’habitude acteur, Seongmo (Shin Seokho) se trouve sur l’île de Jeju dans l’intention de tourner son premier film comme réalisateur. Deux amis l’accompagnent et l’aident : Namhee (Kim Seungyun) a accepté de jouer, et Sangguk (Ha Seongguk) se charge de l’image.
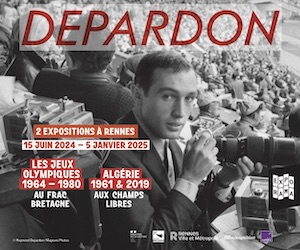
Concentré autour de ce trio, In Water parachève le penchant minimaliste du cinéaste coréen. S’il se classe parmi les opus les plus courts d’un cinéaste adepte de la concision en dépassant à peine une heure, il apparaît aussi du point de vue du contenu comme l’un de ses films les plus légers. Sans rapports générationnels ou enjeux de séduction comme pouvaient en offrir récemment dans De nos jours (2023) ou Walk up (2022), les relations sont ici à peine survolées de gênes et de flottements.
In Water frappe d’abord par une tonalité bienveillante et une ligne amicale qui le rapprochent de La Femme qui s’est enfuie (2020), dans lequel Hong Sangsoo reléguait déjà les tensions (et les personnages masculins) à la périphérie pour mettre en scène une série de rencontres entre une femme mariée et trois amies.
Tandis que le petit groupe arpente tranquillement l’île, les repérages prennent dans In Water un air de promenades, ponctués de discussions où s’expriment une confiance mutuelle et une attention respectueuse, comme lorsque Seognmo s’excuse que son budget restreint ne lui permette pas d’offrir un bon restaurant au lieu de piètres sandwichs. Hong Sangsoo ménage toutefois un léger décalage, à l’image d’un plan où l’apprenti cinéaste s’avance sur le bord d’une route avant d’être rejoint par les autres, s’étonnant de la vitesse du pas de leur camarade.
Seongmo apparaît à plusieurs reprises isolé, travaillé par une incertitude liée à son projet – il n’a pas d’idée précise sur ce qu’il va filmer, le tournage tarde à s’enclencher – mais qui pourrait en excéder les limites. Un bref échange avec une habitante à qui il demande quel est le prix du logement à Jeju suggère ainsi qu’il pourrait songer à s’installer sur
