Des monologues puis Elizabeth Costello – second retour sur Avignon 2024
Elle parle vite comme si les mots se bousculaient dans sa tête, comme si elle voulait en dire le plus possible sans perdre de temps. Ou comme s’il y avait urgence. C’est quelque chose qui l’anime, qui la traverse, qui la rendrait malade presque. Si le débit impérieux, saccadé de la diction de l’artiste suisse Pamina de Coulon est si pressant, c’est que dans ce qu’elle a à nous dire, il est justement question de… débit. Que se passe-t-il, s’interroge-t-elle avec toute cette eau que nous consommons et gaspillons ? Assise ou debout au milieu de structures un peu molles qui pourraient figurer des rochers ou des montagnes tandis qu’en toile de fond une bande de tissu bleu sur fond blanc se froisse en s’élargissant une fois déployée sur le sol, elle évoque son « point de vue d’Alpine » pour qui le Rhône n’est qu’un petit ruisseau.
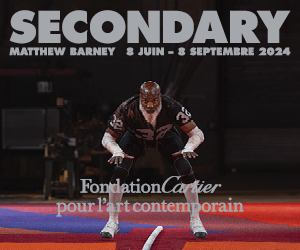
Préoccuppée par l’avenir de la planète, Pamina de Coulon parle toujours à la première personne. Elle dit ce qu’elle ressent, d’où le titre de ce spectacle Fire of Emotions – Niagara 3000. Le fait de mettre ainsi en scène ce qu’elle éprouve donne d’autant plus de poids à son propos dans lequel on ressent « un intérêt personnel infiniment passionné », pour citer Kierkegaard. Cet aspect existentiel, subjectif, associé au mélange de détermination et de fragilité qui émane de sa présence sur scène a le double effet de produire une incontestable empathie et aussi une forme de distance. Cela veut dire qu’en écoutant ce qu’elle a dire, on se sent prêt à en discutter après la représentation avec elle ; ce qui est précisément à quoi invite son spectacle.
Tout commence avec des fleurs – la première serait apparue sur terre il y a cent-trente-cinq millions d’années. De fil en aiguille et du coq à l’âne, Pamina de Coulon aborde, entre autres, les problèmes de la vie, du nucléaire – « qui n’est pas vert » contrairement à ce qu’on voudrait nous faire croire –, des glaciers qui fondent et « nous recrachent des vieux cadavres à la gueule », enfin le fa
