Tuer le frère – sur Miséricorde de Alain Guiraudie
On pourrait sans peine ranger Alain Guiraudie dans la famille des cinéastes obsessionnels. Il y prendrait place par exemple aux côtés de Paul Schrader ou de Fassbinder qui remettent sur le métier de chaque film les mêmes notes pour les jouer sur un mode différent, comme si chaque film fonctionne comme le repentir du précédent.
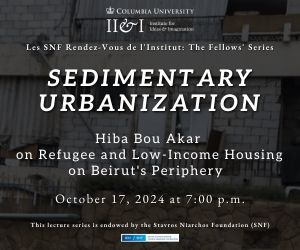
Chez Guiraudie, les ingrédients de base sont toujours les mêmes (circulation du désir, fantasme de mort, goût pour les hommes vieux), mais cuisinés ici différemment, au point que l’on a envie de se livrer au jeu des sept différences.
Négatif de L’Inconnu du lac, polar vénéneux et estival, Miséricorde est un film d’automne qui déploie la gamme chromatique des couleurs chaudes allant du rouge au jaune et au brun tout en racontant la fin d’un monde. Après avoir fait escale par Brest dans Rester vertical et avoir tenté un film purement urbain à Clermont-Ferrand avec Viens je t’emmène, le cinéaste revient à son territoire géographique du Sud-Aveyron.
Dans ce petit village typique, c’est aussi, avec la mort du boulanger, la fin de saison d’une vie à l’ancienne, en autarcie. Guiraudie prend plaisir à en filmer les intérieurs dans tout le prosaïsme des canapés Conforama, de l’écran plat et du tas de linge pas encore plié.
Miséricorde reprend le fil de ses précédents films, comme un long monologue ininterrompu. Depuis Ici commence la nuit qui soldait les frustrations du Roi de l’évasion, Guiraudie fait de son œuvre littéraire (trois romans à ce jour) le terreau dans lequel il puise la matière de ses films, créant des passionnants échos de l’un à l’autre et poussant son style direct à la première personne de célinien campagnard au bout de l’ivresse d’un flot de pensée qui tourne en toupie.
Tourner en boucle
On retrouve dans le petit village de Miséricorde les personnages de Pour les siècles des siècles et Rabalaïre, (tous deux parus chez POL). Si les œuvres filmique et écrit se nourrissent mutuellement en arcs fictionnels, on constate aussi av
