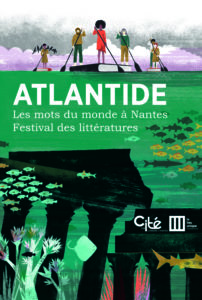François Sureau : « Il me semble que les éléments d’une crise assez grave se trouvent réunis »
Son bureau, situé près du métro Rue du Bac dans le 7e arrondissement de Paris, s’apparente davantage à la caverne d’Ali Baba qu’à un cabinet d’avocat. Tout en bois sombre et cuir, bibliothèques remplies de livres et d’objets d’art rapportés de voyages, les murs tapissés de tableaux, de photos, une maquette de bateau, une marionnette juchée sur une étagère… C’est un homme érudit, à l’élégance toute british, fervent catholique, fumeur de pipe et défenseur des demandeurs d’asile qui nous reçoit. Formé chez les jésuites puis à l’ENA, maître des requêtes au Conseil d’État, passé par la Légion étrangère où il a fini au grade de colonel, aujourd’hui écrivain et avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, gardien des libertés publiques, François Sureau apparaît comme un homme singulier, volontiers inclassable. La binarité n’est pas son fort. On le dit volontiers de droite (son amitié avec François Fillon ou Jean d’Ormesson y a contribué), lui se reconnaîtrait plus à la gauche du spectre politique, même s’il confesse osciller entre les deux selon les jours et selon les sujets. Ce qui est certain, c’est que sur l’immigration et le droit d’asile, il ne se situe pas sur la ligne gouvernementale, lui qui rédigea, en 2016, les statuts de La République En Marche, le parti d’Emmanuel Macron. Déjà très opposé à l’état d’urgence et à l’approche sécuritaire de la lutte contre le terrorisme (Pour la liberté, paru aux éditions Tallandier, reprend ses trois plaidoiries devant le Conseil constitutionnel en sa qualité d’avocat représentant la Ligue des droits de l’homme), il multiplie désormais les apparitions publiques pour critiquer ouvertement le projet de loi « Asile et immigration » en cours d’élaboration et les conditions d’accueil faites aux migrants en France. Pas surprenant : la situation des demandeurs d’asile est l’un de ses chevaux de bataille. Dans son saisissant livre Le Chemin des morts, qui vient de paraître en poche, il raconte comment, jeune conseiller d’État, il a été conduit à trancher, en 1983, à propos du renvoi dans une Espagne devenue démocratique d’un réfugié politique basque. Finalement expulsé, Javier Ibarrategui fut exécuté par un commando lié à l’ancienne police franquiste. Cette histoire hante encore l’avocat qui, avec sa femme, a fondé, il y a dix ans, une association d’aide, d’accompagnement et d’étude pour demandeurs d’asile, l’association Pierre Claver. Actualité, politique, droit, littérature, telle est la matière de cet entretien.
En ce mois de janvier, plusieurs médias ont vu le jour, et d’autres s’annoncent. Comment expliquez-vous ce besoin de nouveaux médias ?
Franchement, je ne sais pas si l’apparition de nouveaux médias correspond à un besoin du lectorat ou un désir de ceux qui les inventent de proposer des voies nouvelles de compréhension. En tout cas c’est un désir que j’approuve hautement. Il me semble que nous n’avons jamais, en France du moins, manqué à ce point de lieux pour une discussion intelligente. Sur les sujets qui me tiennent à cœur, l’asile, les libertés, la répression pénale, il est frappant de voir que la presque totalité des vecteurs d’information existants tendent à enfermer le débat intellectuel dans des catégories politiques, et même de politique intérieure sommaires : on est pour la schlague ou pour l’anarchie, on est pour l’immigration incontrôlée ou l’on est xénophobe. C’est fait plus ou moins subtilement, bien sûr, mais c’est toujours fâcheux. Dans ce mouvement, les questions essentielles sont à peu près oubliées : si l’on défend la liberté, quelle part fait-on dans cette défense à la recherche de la vérité ? Si l’on défend l’asile, quelle étendue doit-on donner à cette notion même, un asile proprement politique, un asile plus compréhensif, plus existentiel ?
AOC est un journal qui va faire la part belle aux idées : en manque-t-on aujourd’hui en France ?
Nous sommes peut-être moins en manque d’idées que de forums intelligents, où les idées qui circulent, et il y en a, seraient mises à la disposition du public pour pouvoir être discutées profondément, longuement. Ce qui me frappe particulièrement en France, ces temps-ci, c’est la disparition d’un regard critique, informé, sur nous-mêmes. Prenez par exemple la question des libertés. Il est frappant de voir que les « défenseurs de la liberté », catégorie dans laquelle j’aime me ranger, défendent ses principes contre les atteintes qui lui sont portées depuis vingt ou trente ans par un Parlement émotif et des politiciens intéressés, dans le sens d’une répression toujours plus grande. Soit. Mais en même temps, ce combat s’accompagne de pas mal d’illusions. On raisonne toujours comme si nous étions, de fondation, le « pays de la liberté », avec seulement ici et là quelques épisodes noirs, Vichy, les empires, la répression de la Commune. Mais c’est le contraire qui est vrai. Nous sommes depuis 1793 le pays du contrôle administratif, avec seulement quelques éclaircies, à la fin du XIXe notamment, et il a fallu attendre 1971 pour que la déclaration des droits s’applique aux lois votées par le Parlement. C’est un exemple parmi d’autres. Nous avons un chemin de lucidité à parcourir.
Dans quel état d’esprit entamez-vous cette nouvelle année ?
Dans un état d’esprit à la fois combatif et contemplatif. Combatif, parce qu’il me semble que nous restons plongés en France, malgré l’élection d’un président nouveau, dans un état de grande confusion quant à ce qui nous constitue, sur le front des principes essentiels ; et parce qu’au fond nous ne sommes pas du tout dotés de la structure politique qui nous permettrait d’affronter les débats du jour : un président omniprésent, un gouvernement très faible, un Parlement qui ne parvient pas à trouver sa place entre l’agitation adolescente et la tentation de l’hyperlégislation, et, aux commandes de l’État, une bureaucratie qui tend à régler les problèmes des Français, même avec les meilleurs intentions du monde, en termes de bureaucratie, c’est-à-dire selon sa rhétorique, ses procédés, ses intérêts propres. Je ne suis pas exagérément optimiste. En fait, il me semble que les éléments d’une crise assez grave se trouvent réunis, même si l’on ne peut prévoir laquelle. Mais aussi je suis dans un état d’esprit contemplatif, par goût, par amour de la littérature, et parce que je crois essentiel de nous refuser chaque jour à cet envahissement par l’opinion, l’idée générale, l’émotion collective, qui est l’une des données les plus fatigantes d’un temps dont la stérilité est en proportion de son agitation.
Comment peut-on faire face aux fake news et aux théories du complot qui ne cessent de se répandre, jusqu’au sommet de la première puissance du monde : par la loi, comme l’a évoqué le chef de l’État ?
Commençons par les traduire : « fausses nouvelles ». Si vous les traduisez, vous voyez tout de suite l’ampleur du problème. La politique est une gigantesque usine à fausses nouvelles. Quand j’étais jeune, j’apprenais la géographie dans les ouvrages d’un auteur absolument stalinien, qui était la référence unique, et qui expliquait jusque dans ses « Que sais-je », vers 1975, que dans quelques années l’URSS serait devenue la première puissance économique du monde devant les USA. Quand le mur est tombé, des statistiques sérieuses ont montré que le PIB de l’URSS était à peu près celui de la Belgique. Je me souviens de Simon Leys, qui avait entrepris de décrire la révolution culturelle pour ce qu’elle était. C’était lui à l’époque qui était insulté à longueur de colonnes comme un propagateur de « fausses nouvelles ». Le Monde le peignait même en agent payé de la CIA. Les exemples sont innombrables. À l’autre bout, on peut prendre l’exemple de la forgerie pure, les « protocoles des sages de Sion ». Je suis convaincu que leur interdiction aurait apporté, apporterait encore un surcroît de crédibilité à ces inepties. Bref il me semble qu’il faut en revenir à l’essentiel. Le principe démocratique, c’est que seule la liberté, l’expression libre, dont un citoyen réputé intelligent peut faire l’usage qu’il veut, permet la recherche de la vérité et l’expression du choix politique. Ni l’administration, ni le législateur, ni le juge, n’ont qualité pour intervenir dans ce débat. Et pour cause. D’abord, sauf à être complètement naïf, on voit bien que rien ne peut garantir leur neutralité axiologique. Ensuite, il y a l’effet de « crédibilisation négative » dont je viens de parler. Enfin, à partir du moment où on a admis en principe que la liberté de diffusion pourrait être limitée, on a ouvert la voie à d’autres atteintes, qui pourront être plus graves. Je suis frappé que ces questions ne soient jamais envisagées « dans le temps ». Qui définira la « fausse nouvelle » ? Après tout, jusqu’à ce qu’il en fasse l’aveu, la fraude fiscale de Cahuzac aurait tout à fait pu être considérée comme une fausse nouvelle. Et qu’arrivera-t-il lorsqu’un juge des référés qualifiera de fausse nouvelle une nouvelle dont l’avenir montrera qu’elle n’en était pas une ? Refera-t-on l’élection ? La législation me paraît donc une mauvaise idée. La seule chose qui, à mes yeux, pourrait être envisagée, c’est que la production de « faux » avérés puisse être empêchée par le juge dans la période électorale. Un faux compte en banque en Suisse, que sais je encore. Mais je préfère de loin que l’on continue de faire confiance au jeu démocratique. Face à une « fausse nouvelle », que ceux qui en sont les victimes politiques s’organisent pour les dénoncer. Le juge a mission de garantir la régularité procédurale d’une élection. Il ne peut en aucun cas se prononcer sur les contenus des messages à caractère politique véhiculés dans la campagne électorale.
Nous finissons par parer les opinions les plus abjectes de l’éclat de la censure judiciaire.
Et que faire face au déferlement de haine sur les réseaux sociaux ? À partir de quand convient-il de condamner des propos ?
Quant aux théories du complot, il est sûr que leur vogue, attestée par quelques études récentes, est extrêmement préoccupante. Mais là encore, il faut remettre cette question en perspective. L’idée du « complot » est consubstantielle à la vie démocratique, dans la mesure où aucune vérité ne peut y être tenue pour absolument définitive ou absolument sacrée. Nous avons connu l’explication de la Révolution par le complot maçonnique, le complot ploutocratique cher à l’extrême droite, le complot des deux cent familles cher à l’extrême gauche. Ce dernier exemple montre d’ailleurs comment on passe facilement de l’explication au complot : l’idée du « mur de l’argent » n’était pas si bête, et l’on voit bien comment on peut passer d’une analyse en termes de classes, avec le dispositif interprétatif qu’elle suppose, à une analyse en termes de « forces occultes », c’est-à-dire cachées. Après tout, les grands « herméneutes du soupçon », à commencer par Marx ou Freud, ne font rien d’autre que de dévoiler des ressorts cachés. Nous sommes les enfants de ce soupçon-là. Il n’y a que quelques pas à faire pour passer de la volonté de ne pas être dupe à l’illusion du complot. Peut-être cependant y a-t-il une nouveauté contemporaine. D’une part, le complot correspond certainement à une recherche de sens, d’autant plus puissante que désormais le « sens » paraît échapper à tout le monde. D’autre part, la tentation du complot n’est plus canalisée par un appareil intellectuel, comme elle pouvait l’être chez les maurassiens d’un côté, chez les léninistes de l’autre. Elle échappe à toute forme de régulation. Elle ne reflète plus que la passion, ou le préjugé purs. La Terre est plate, le complot sioniste est partout, Davos mène le monde et la DGSE a armé la main des tueurs du Bataclan. C’est difficile à combattre parce que la bêtise est de tous les ennemis de la démocratie le plus redoutable. Mais ce qui est sûr, c’est que seule l’éducation à l’intelligence critique permettra d’élever des digues. Et que ce travail sera toujours à reprendre.
Vous parlez de l’importance de « l’éducation critique » : comment s’y prend-on pour la développer ?
Dès le secondaire, et ensuite à l’université. Mais nous avons un sérieux effort de décrassage à faire. Les théories du complot prospèrent en effet sur le terreau des illusions dont je parlais tout à l’heure, et sur nos contradictions internes. Comment peut-on à la fois considérer, comme nombre d’historiens de la Révolution le font encore, fût-ce implicitement, la Terreur comme un mal nécessaire, et condamner toute forme de terrorisme ? Comment oublier de discerner, ce qui dans la vie politique au temps de la Révolution, a relevé de la théorie du complot ? Une foule d’exemples plus contemporains vient à l’esprit, mais j’ai choisi ceux-là parce que nous avons tendance à fétichiser, pour le condamner ou pour l’absoudre, l’épisode révolutionnaire. Le regard critique, c’est l’affaire de toute une vie de citoyen. Avec ce qu’il apporte d’écart, de méfiance sereine. En évitant ce goût de l’anathème qui est l’un des traits les plus pénibles de l’époque. Je ne suis pas un tenant des motions chèvre-chou, ni des compromis radicaux, mais j’aimerais que les cervelles puissent être exposées à la fois à Finkielkraut, à Waresquiel et à Boucheron, dont L’Histoire mondiale de la France m’a fasciné, autrement qu’à la lueur des bûchers.
De façon générale, n’avons-nous pas tendance à faire trop confiance à l’arsenal législatif au détriment du discours intellectuel et politique ?
Poser la question comme vous le faites, c’est y répondre. Je suis frappé de notre appétence collective pour la censure, quels que soient les oripeaux bien-pensants dont on l’habille. C’est une pente extrêmement dangereuse. Nous finissons par parer les opinions les plus abjectes de l’éclat de la censure judiciaire. Regardez, dira-t-on, les juges ont condamné Baudelaire et Flaubert, et maintenant ils condamnent Soral. Je ne sais d’où nous est venue l’idée de transformer les juges en représentants sur la terre de ce Dieu auquel nous ne croyons plus. Ce sont de pauvres hommes comme nous, avec leurs préjugés, leurs insuffisances intellectuelles. J’ai suivi le débat judiciaire ou le grand historien Lewis était accusé d’avoir « minoré » le génocide arménien. Ce n’est pas sans malaise que l’on y a vu le président Tartemolle se transformer en président de jury de l’agrégation d’histoire. Il y était bien obligé, le malheureux, la législation l’y forçait. Mais ces spectacles sont du dernier ridicule. Que l’on réprime la provocation directe à la haine raciale, c’est normal, c’est une question d’ordre public. Qu’on interdise un spectacle de Dieudonné pour les mêmes raisons, sur le fondement de la célèbre jurisprudence Benjamin du Conseil d’État, je suis aussi d’accord. Mais que l’on n’aille pas au-delà.
Comment avez-vous regardé le mouvement issu de l’affaire Weinstein ? S’agissant du harcèlement sexuel, là encore, faut-il légiférer ou éduquer ?
Je suis frappé par ces mouvements conjoints, simultanés, qui me paraissent d’abord relever de la peur. On dirait que les Français ont peur : peur de leurs antisémites fulminants, peur de leurs terroristes islamistes, peur de leurs obsédés sexuels, de leurs harceleurs, de leurs pédophiles. Et vous remarquerez qu’à chaque fois un puissant courant d’opinion réclame des châtiments exemplaires, et se déclare prêt à jeter à la rivière toutes les garanties de notre droit, tous nos principes. Il faut enfermer les pédophiles même après qu’ils ont purgé leur peine, enfermer les fichés « S » sans même qu’ils aient été jugés, clouer les harceleurs au pilori en dehors de tout débat judiciaire. Comme tout le monde, ou du moins comme beaucoup, je réprouve les actes dont nous parlons. Mais s’il s’agit de mettre fin, y compris en paroles, à l’existence sociale des personnes, c’est autre chose. Nous rejouons chaque jour en toute innocence le procès des sorcières de Salem. Il n’y a jamais eu autant de sermonneurs, jamais eu autant d’inquisiteurs, que depuis que l’on ne va plus écouter les prêches à l’église, le dimanche. Les prêches sont partout et le désir de supplices aussi. La télévision publique interroge des témoins à charge en plein procès. La ministre de la Défense exprime benoîtement son désir de voir exécuter sans jugement des prisonniers de guerre. Tout va bien. Nous avons notre conscience pour nous. L’intelligence, c’est autre chose. Et là encore, nous ne sommes pas effrayés par nos contradictions, que nous passons aisément sous silence. En théorie, toutes les transgressions sont bonnes à prendre, et universellement louées. En pratique, on réclame d’« éduquer » les garçons et les filles, c’est-à-dire le retour de la morale, avec une naïveté surprenante, comme si nous pouvions faire abstraction de ce monde étrange que de l’autre main nous contribuons sans cesse à créer, où la dignité est tenue pour à peu près rien, la dignité des pauvres, des réfugiés, des sans-abri, de tous les inadaptés de notre monde de compétition, où tout s’achète et se vend, les corps, les élections, les journaux, les réputations, dans l’assentiment général. Idolâtres du corps, nous nous étonnons que le désir ne se laisse pas arrêter par la loi ou par la bienséance. Idolâtres de l’entreprise, nous nous choquons qu’elle licencie. Idolâtres de la politique, nous lui reprochons de mentir. On n’est pas plus inconséquents. Nous ressentons la présence du mal. Nous ne savons plus le nommer. Nous avons perdu l’espoir religieux de le faire concourir au salut, l’espoir politique de le réduire en édifiant une société meilleure. Le mal subsiste et nous ne savons qu’en faire. Nous essayons de lui trouver des raisons, alors qu’il est de son essence de ne pas en avoir. Alors nous essayons de l’oublier, en censurant ses expressions inacceptables et en exécutant, de temps à autre, les boucs émissaires que nous chargeons de nos insupportables fardeaux. Il n’y a rien là-dedans qui me réjouisse. Mais rien non plus qui m’étonne.
Il y a d’un côté nos fétiches collectifs, bien rangés sur les étagères, de l’autre notre désir de châtiments exemplaires, et au diable la justice. C’est extrêmement dangereux.
Début janvier on a commémoré les trois ans des attentats de janvier 2015. Peut-on parler de progrès ou de régression de la liberté d’expression en trois ans ?
Nous pouvons il me semble parler d’un double mouvement, à mes yeux assez inquiétant. D’un coté une sorte de « progrès négatif » de la liberté d’expression, avec une libération de toutes les dingueries. De l’autre côté une autorisation chaque année plus lourde donnée aux autorités publiques de « réguler », comme on dit, les idées, les raisonnements, les expressions, les consciences. On n’en voit pas la fin.
Comment comprenez-vous la crispation des débats autour de la laïcité et de l’islam en France ?
Curieusement, je n’ai pas une appréciation négative de ce débat. Il me paraît présenter l’avantage de poser une question difficile en termes essentiellement politiques, c’est-à-dire civilisés. Après tout, si l’on veut bien regarder la réalité en face, voici vingt ans que se commettent en France des attentats terroristes au nom d’une religion particulière. Que je sache, les tueurs du Bataclan ne criaient pas « vive le grand Baal Melkart ! ». Il y a eu des actes ponctuels d’hostilité à l’égard des lieux de culte musulmans, mais le pays n’a pas cédé à une fureur irraisonnée. Le souci de distinguer les terroristes des musulmans en général a été très présent. Et les questions se sont déplacées sur le terrain institutionnel. C’est le point où nous en sommes. La difficulté à présent me paraît double. D’une part, comment régler l’affaire sans pour autant rejeter la religion dans la « sphère privée », ce qui est une atteinte à la liberté d’expression ? Je ne vois vraiment pas pourquoi, sauf à fétichiser la religion, on autoriserait un prêche politique dans un jardin public alors qu’on y interdirait un prêche religieux. Mais nous touchons là à l’un des éléments constitutifs, peut-être, de cette laïcité à la française, qui a procédé de la conquête de l’autonomie du politique par rapport au catholicisme, et qui en gardé des traits fortement militants, voire même, parfois, liberticides. D’autre part, comment apprécier exactement, et parfois combattre, les traits d’une religion donnée qui nous paraîtraient — droits des femmes, liberté de propos allant jusqu’au « blasphème », liberté de conscience et donc d’apostasie — contraires à nos principes fondamentaux, sans pour autant s’immiscer dans le secret des consciences ? J’espère que nous trouverons un point d’équilibre, mais je suis déjà heureux que notre réponse collective soit essentiellement une réponse politique.
Qu’avez-vous pensé du procès d’Abdelkader Merah et de la ligne de défense de Me Dupont-Moretti (ne pas céder aux terroristes qui visent à nous faire changer notre mode de vie, notre mode de penser et notre mode de juger ; maintenir notre règle de droit donc ne pas juger un homme sans preuves ; ne pas céder aux pressions de la société civile qui veulent lyncher un homme pour en faire un exemple, ne pas se laisser « anesthésier » par le terrorisme) ?
La ligne que vous attribuez à Dupont-Moretti, ce n’est pas la sienne, c’est celle de notre droit depuis bien avant la Révolution française, c’est celle de notre honneur collectif, c’est celle de la société que nous avons voulu édifier, depuis des siècles, et qui nous a coûté tant de sang et tant d’efforts. Une large partie de l’opinion, comme de la classe politique, n’en a cure et préfèrerait adopter une attitude directement reptilienne. La loi de Lynch fait un retour en force. Je n’ai pas de compassion pour les terroristes. Mais je ne peux me déprendre de l’impression gênante que le frère de Merah a été lourdement condamné parce qu’il était le frère de l’assassin, et de voir quelque chose de sinistre dans ce retour à l’idée de responsabilité collective. D’autant que c’est un retour que rien ne justifie. Je pourrais comprendre qu’on critique notre système de droit s’il était indulgent. Il ne l’est pas le moins du monde. Les moyens d’investigation, les instruments de poursuite y sont particulièrement efficaces. Il ne se passe pourtant pas de mois ou l’on nous propose de nous asseoir sur les principes pour obtenir une efficacité plus grande : en finir avec le juge, garant des libertés, lâcher la bride au corps préfectoral et à la police, museler la défense, s’impatienter des règles du procès contradictoire. Avec ces beaux raisonnements, Dreyfus serait mort à Cayenne, mais tout le monde s’en fout. Il y a d’un côté nos fétiches collectifs, bien rangés sur les étagères, de l’autre notre désir de châtiments exemplaires, et au diable la justice. C’est extrêmement dangereux, simplement parce qu’un ordre injuste n’est pas durable et pour finir ne garantit rien. Nous nous croyons nés de la dernière pluie, et nous pensons que c’est la première fois que le problème se pose. Pas du tout. À chaque fois, dans le passé, qu’un drame a ému l’opinion, les mêmes voix se sont fait entendre. Et elles sont puissamment relayées par les hérauts administratifs, juges, politiques, policiers, de la machine répressive, qui tous voient les principes sur lesquels notre civilisation se fonde comme des obstacles à la noble activité de condamner en rond, à l’abri des regards. Roger Frey, ministre de l’Intérieur du Général, le disait déjà dans les années 60 : il n’y pas de semaine sans qu’un ministre de l’Intérieur ne se voie proposer un texte qui supprimerait les libertés sous le fallacieux prétexte que l’activité de la police en serait rendue plus facile. Et les mêmes de menacer des pires catastrophes au cas où ils ne seraient pas suivis dans leurs outrances. Ils le disaient déjà au moment de la suppression du bagne, ou de l’abolition de la peine de mort, de l’introduction de l’avocat dans les gardes à vue.
Face à la menace djihadiste, vous défendez une ligne plus « libertaire » que « sécuritaire ». Vous avez d’ailleurs publié les trois plaidoiries que vous avez faites devant le Conseil constitutionnel comme avocat représentant la Ligue des droits de l’homme, dans un livre Pour la liberté. Comment combattre le terrorisme avec les armes du droit et de la démocratie ?
Je tiens pour ma part que les armes du droit et de la démocratie sont les plus efficaces pour combattre un terrorisme sur lequel je ne me fais aucune illusion. D’abord, pris en lui-même, notre système de droit le permet absolument. Le code pénal a été modifié plus de dix fois en douze ans. À qui fera-t-on croire qu’il en a résulté une efficacité plus grande ? Les peines sont là, sévères. Les juges sont là, formés et compétents. Les procédures sont là, et permettent même d’appréhender quelqu’un avant qu’il n’ait commis un acte terroriste. Il y a, en ce domaine, une véritable imposture dans ce mouvement par lequel les gouvernements successifs abattent notre système par pans entiers, au détriment de tous, et sans effet pratique, pour faire oublier qu’ils ne réforment pas les institutions de sécurité, ne leurs donnent pas davantage de moyens, ne s’attaquent pas aux causes, nombreuses et variées, du mal terroriste. Ensuite, et plus profondément encore, je ne vois pas comment nous pourrions accepter d’accorder aux terroristes cette formidable victoire symbolique d’abandonner, au moment de la lutte, les principes au nom desquels nous les combattons, alors surtout que ces principes sont parfaitement compatibles avec l’efficacité. Il n’y a pas, Dieu merci, à choisir entre le mode gégène et le mode Bisounours.
Comment vivre aujourd’hui dans une société libre sans avoir peur ?
La peur, elle, sera sûrement présente parmi nous. Mais elle a à voir avec le prix infini de la société de liberté, par nature plus incertaine, peut-être plus fragile qu’une autre. J’ai entendu récemment un membre du gouvernement déclarer que la sécurité était « la première des libertés ». Si tel était le cas, nous devrions voir comme un paradis de liberté le Moscou de Staline, ou le Palerme de Mussolini, où sans doute la sécurité était à peu près sans défaut. Est-ce cela que nous voulons ?
Il n’y a pas de position plus ridicule que celle de visiteur du soir. Le soir, j’essaye plutôt d’écrire des livres.
Vous n’appréciez pas la politique migratoire du ministre de l’Intérieur. Vous avez exprimé votre point de vue dans une récente chronique pour le journal La Croix. C’est une conception du droit d’asile que vous défendez. Ne faites-vous pas preuve d’angélisme en la matière ?
Je ne crois pas faire preuve d’angélisme. La question de l’asile est une question très difficile, qui ne sera pas réglée par la confrontation actuelle, qui donne un peu le ton, entre la gestion policière du système de l’asile, d’une part, et l’indignation compréhensible de nombres d’associations, animées également par une option à mes yeux discutable de refus de toute idée de choix, de discernement. Si je commence par l’option policière, c’est une option continûment assumée par l’ensemble des gouvernements depuis dix ans. Le discours officiel des ministres, en ce domaine, c’est qu’il faudrait se montrer plus sévère pour sauver le droit d’asile, notamment en distinguant mieux les « vrais » des « faux » réfugiés. Ce discours pourrait s’entendre si les positions émanant des administrations depuis plus de dix ans n’étaient pas toutes défavorables au système de l’asile en général. Et ces positions, notez-le, sont toutes antérieures à la « vague migratoire », datant d’époques où les demandes annuelles étaient à peine le tiers de ce qu’elles sont aujourd’hui : impossibilité de parvenir régulièrement sur le territoire français pour y demander l’asile, ce qui est contraire à nos obligations internationales et fait de nous les complices des morts en Méditerranée ; volonté de réduire à quinze jours le délai pour faire appel d’une décision de refus d’asile, ce qui est sidérant quand on pense qu’il s’agit de personnes isolées, errantes, peu informées, ne parlant pas le français ; idée, proprement surréaliste, des « pays tiers sûrs », proposée encore récemment par l’administration, et consistant à refuser une demande d’asile au motif que le demandeur pouvait très bien, s’il était syrien par exemple, rester au Liban ou en Turquie, où après tout il ne risquait rien. Avec ce raisonnement on aurait pu tout aussi bien refuser l’asile à tel juif allemand en 1936 en lui expliquant qu’il était passé par la Belgique et pouvait tout à fait y rester, à tel réfugié hongrois de 1956 qu’il devait s’estimer content de finir ses jours en Autriche, alors que l’un et l’autre, ayant tout perdu, auraient désiré plus que tout trouver en France, et en France seulement, une seconde patrie. Vous comprendrez que de telles propositions jettent un fort soupçon sur l’amour du droit d’asile dont se prévaut le gouvernement. Et je ne parle pas de ce que tout le monde connaît et que le Conseil d’État parfois sanctionne en référé, les conditions d’accueil déplorables, indignes, inspirées par l’idée que les « migrants » seront dissuadés de venir si la vie chez nous est suffisamment difficile.
Mais l’option de l’ouverture intégrale n’est pas non plus satisfaisante. Entendons-nous, il me semble inacceptable de demander aux personnels qui accueillent dans les centres de participer au contrôle administratif. Inacceptable en droit, insensible sur le plan humain, et aussi inepte, puisque cela dissuadera les gens de chercher refuge dans ces centres. Le « tri » humain est insupportable. Mais en revanche, l’asile lui-même suppose de discerner qui peut, ou non, se prévaloir des conditions posées par la convention de Genève, qui a été persécuté, qui craint à juste raison de l’être en cas de retour dans le pays qu’il a fui. C’est tout le propos des institutions de l’asile. Et il est sûr que son engorgement actuel défavorise relativement les victimes de persécutions effectives, par rapport aux autres, et qu’il serait injuste de ne pas en tenir compte. Ce que les exilés viennent nous demander, au plus profond, c’est la dignité de sujets de droit, une dignité que leur pays leur refuse. Je ne vois pas comment nous pourrions oublier cela. Et ceci suppose d’une part de nous refuser à voir le droit manipulé pour prévenir la demande d’asile, option « policière », ou négligé pour favoriser l’accueil inconditionnel, option « humanitaire ». La voie est étroite. Ce qui est sûr, c’est que le gouvernement n’a pas su la trouver, en ce qu’elle suppose de créer un dispositif de l’asile totalement indépendant, régionalisé, doté de davantage de moyens. Et aussi de repenser les critères de l’asile. Nous n’en sommes plus à l’époque de l’asile politique pur, mais nous ne sommes pas non plus, contrairement à ce que dit la droite et même une partie de la gauche, dans l’asile « économique », asile de travail ou chasse aux allocations. Nous sommes entrés dans le moment de l’asile « existentiel ». Les réfugiés fuient des pays où ni leur dignité ni leur liberté de personnes ne sont plus garanties : choix d’une vie, d’un métier, d’une vocation, d’un amour, de l’existence entière. Comment ne pas les comprendre ? d’autant que très souvent, ils viennent de pays avec lesquels nous entretenons les meilleures relations, dont nous encourageons les régimes les plus souvent despotiques, sur les trafics et les exactions desquels nous nous sommes faits une spécialité de fermer les yeux, ou même pire.
D’où vous vient cette préoccupation particulière pour le droit d’asile ? De l’histoire que vous racontez dans Le Chemin des morts ?
Je ne voudrais pas vous paraître trop littéraire, mais cette préoccupation pour l’asile me vient de la nostalgie imprécise d’un pays perdu. Même ceux qui comme moi auront passé leur vie « accrochés à la nacre natale », comme dit Nabokov, peuvent s’en trouver atteints, un jour ou l’autre.
Malgré vos critiques à l’encontre de la politique migratoire du gouvernement et des lois anti-terroristes, vous avez l’oreille du président. Qu’est-ce qui vous rapproche de lui ?
L’oreille du président ? Je n’en sais rien. Au fond je ne crois pas. Il n’y a pas de position plus ridicule que celle de visiteur du soir. Le soir, j’essaye plutôt d’écrire des livres. Un président, ça vit dans un autre monde, soumis à des contraintes dont je n’ai pas l’idée, dont je n’essaye pas d’ailleurs d’avoir l’idée. Il y a le conseiller néo-technocratique, il y a le conseiller prophétique ; l’habile, et l’éléphant dans un magasin de porcelaine. Je me sens incapable d’être l’un ou l’autre. Je n’attends pas qu’on m’appelle. Quand on m’appelle, je n’attends pas qu’on m’écoute. Je suis donc rarement déçu.
Les valeurs de gauche et de droite ont-elles encore un sens ? Vous diriez-vous de droite ET de gauche, NI de gauche NI de droite, de gauche OU de droite ?
Ces classements procèdent toujours un peu du désir d’idéaliser la politique, et je ne suis pas porté à l’idéaliser. En s’avouant de droite ou de gauche, on se sauve, on se justifie, on se réclame de précédents illustres, on se distingue en s’opposant. C’est bien commode. La vérité, c’est que le plus souvent, comme disait mon ami Jean d’Ormesson, quand je me trouve avec des gens de droite je me trouve vraiment à gauche, et quand je me trouve avec des gens de gauche, vraiment à droite, même si à la fin des fins, la vie qui passe m’a rendu de plus en plus sensible à l’injustice, aux dégâts de la broyeuse sociale, à l’imposture des institutions. Je préfère le désordre à l’injustice, tout en sachant que de grandes injustices peuvent naître du désordre. Au fond, ce que j’aime avant tout dans un tempérament politique, c’est le refus de se voir soi-même comme appelé à « diriger », à « gouverner », à « commander ». « Ce que j’aime en ma folie, c’est qu’elle m’a protégé, du premier jour, contre les séductions de “l’élite”. Jamais je ne me suis cru l’heureux propriétaire d’un “talent” : ma seule affaire était de me sauver — rien dans les mains, rien dans les poches — par le travail et la foi. » Cette phrase des Mots figurait sur la première page de Libé le jour où Sartre est mort. Seulement lui, de dos, et cette phrase, même pas son nom. J’ai longtemps conservé ce bout de journal, plié, jauni, au fond de mon portefeuille, comme un talisman.
Vous avez été conseiller d’État pendant une quinzaine d’années. N’avez-vous jamais été tenté par les allées du pouvoir ?
Non, je n’ai jamais été tenté par ces allées-là, peut-être parce que je me méfiais de moi-même, que je savais ce que je deviendrais si je me laissais tenter. Et comme ma réticence devait se voir, jamais personne ne m’a proposé d’occuper aucun poste, aucune fonction. J’en ai été heureux, et chaque jour qui passe je le suis davantage.
La langue du droit organise le réel, au contraire de celle de la littérature qui veut en rendre compte, ce qui est très différent.
Vous avez suivi des études chez les jésuites du collège Franklin à Paris, vous êtes croyant. Quelle est la place de la foi dans votre trajectoire ?
S’il faut s’en tenir au pittoresque des représentations, de soi et de la société, c’est vrai que j’aurais aimé être un catholique anglais, Waugh, Belloc, Chesterton, minoritaire, raisonnablement inacceptable par des excès et son excentricité. Les hasards de la naissance ne l’ont pas voulu ainsi. Je redeviens sérieux, puisqu’il n’y a pas de question plus sérieuse ; et c’est précisément pourquoi je ne vais pas en parler. Je suis d’un temps heureux où l’on ne parlait pas de religion, où l’on en parlait d’autant moins qu’on en avait, où l’on n’en parlait pas par politesse aussi. J’ai la nostalgie de ce temps. J’ai parfois l’impression de vivre dans un monstrueux syndicat d’initiative des religions, où chacune vante les beautés de sa doctrine, et je n’en exempte pas l’athéisme. Je déteste, disait Jaspers, cette tendance qu’ont certains hommes de vouloir en instruire d’autres au sujet de Dieu. C’est vrai, j’ai été élevé dans un collège de jésuites. Mais les jésuites de ce temps étaient étonnamment discrets. Il a fallu attendre qu’ils s’en aillent pour que les laïcs « engagés » viennent nous bassiner avec « le charisme ignatien », et que les mères de famille viennent faire le catéchisme. Heureusement, je suis parti avant. Il y avait autour des pères jésuites un certain mystère. Plusieurs étaient furieusement intelligents, ils auraient pu avoir ce qu’on appelle « de belles carrières », et pourtant ils vivaient pauvrement au milieu des enfants des riches. Certains avaient eu pendant la guerre une attitude exemplaire. Je me souviens de l’un d’entre eux, qui nous a fait découvrir Kafka, d’un autre qui commentait Bresson au cinéclub. Par sa discrétion, par sa retenue, par l’exemple aussi, leur influence était libératrice. En tout cas ça a été le cas pour moi. Bien plus tard, ayant publié sur Ignace, j’ai croisé l’un de mes vieux maîtres et je lui ai reproché de ne nous avoir jamais parlé de lui. Après un temps, il a dit, sardonique : « C’est que voyez-vous, Ignace, vous le savez à présent, n’est pas un auteur pour les petits garçons ». Et c’était vrai.
A-t-elle quelque chose à voir avec votre engagement ?
Je ne dirai rien de la vie spirituelle, rien non plus du désir d’engagement qu’elle peut faire naître et qui reste ensuite si difficile à poursuivre jour après jour, rien donc de ce mystérieux royaume, présent au milieu de nous, mais à condition que nous fassions ces efforts si difficiles à faire que Bloom, le métropolite orthodoxe de Londres, un des grands esprits religieux du siècle, disait à la BBC qu’il avait honte à chaque fois qu’on le présentait comme chrétien. Et quant à l’engagement, je dirais simplement mon admiration pour les gens, j’en ai connu en assez grand nombre, qui, ne se définissant pas comme religieux, professant l’athéisme le plus strict ou agnostiques, en remontreraient à la plupart des croyants, dont moi-même, au chapitre de la fraternité et du dévouement. Mais je dois aussi avouer que ma religion, comme on disait autrefois, m’a rendu sensible aux idolâtries, si présentes dans un monde incroyant, et aussi, soyons justes, dans le monde croyant : idolâtrie de la politique, de l’argent, du marché, des institutions quelle qu’elles soient.
Vous fréquentez la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre à Paris de l’Église grecque melkite : qu’appréciez-vous dans la tradition catholique orientale que vous ne trouvez pas ailleurs ?
La tradition liturgique orientale, c’est la tradition byzantine, c’est, dans sa substance, celle de l’orthodoxie. J’en aime les chants, le mystère étonnamment familier, et cette idée, qui oriente tout, d’un Dieu de la guérison bien avant d’être celui de la loi, du commandement. Étrangement, quand je l’ai découverte alors que rien ne m’y avait préparé, j’ai cru rentrer chez moi.
Vous êtes écrivain et avocat. Voyez-vous un rapport entre les deux ? L’amour de la langue ? La quête de la vérité de l’être humain ?
Je ne vois presque aucun rapport entre les deux, et je dirais même qu’à mes yeux il s’agit de deux mondes antagonistes. La langue du droit organise le réel, au contraire de celle de la littérature qui veut en rendre compte, ce qui est très différent. Le monde de l’avocat est un monde de conflit, où il faut choisir son camp, alors que la littérature, sauf dans la polémique, ne peut s’engager dans cette voie sauf à se perdre. La vérité de l’être humain n’est connue de personne, sauf de Dieu si l’on y croit. Ni de l’avocat, ni de l’écrivain. Le droit ruse avec cet inconnaissable, et la littérature en donne une représentation dans l’art, ce qui est encore autre chose mais ne peut pas davantage prétendre à la vérité.
Peut-être au fond le droit et la littérature peuvent-ils se rejoindre dans l’invisible, dans ce sentiment imprécis de la justice qui oriente nos destinées terrestres sans que nous en ayons le plus souvent conscience… Qui sait ?
Êtes-vous de ceux qui instruiraient le procès de la fiction ou qui la défendraient au nom de la liberté de création ?
Procès de la fiction ou liberté de la création ? L’un et l’autre et dans la même mesure. Je défends l’idée, bien sûr, d’une liberté absolue, car en ce domaine il n’y aucun compromis qui vaille, il n’y a que le jugement de l’auteur et du lecteur d’une part, le jugement du censeur de l’autre, et je ne reconnais à personne le droit de censurer. Mais d’un autre côté je me range dans le camp de Stevenson, qui dans ses notes critiques ne pense pas que l’on puisse tenir l’art quitte des réquisitions du bien. Il ne s’agit pas ici, ou pas seulement, de ce qu’on appelle la responsabilité de l’artiste, dans la mesure ou personne ne peut en juger que lui-même : mais plutôt de ce que l’art doit, dans son achèvement, sa portée esthétique, à la tension vers le bien, et qui détermine sa valeur secrète. Et cette tension est présente même dans les œuvres d’auteurs absolument haïssables à mes yeux. Elle est présente par exemple dans D’un château l’autre, pour parler d’un auteur qui ne cesse d’être un objet de controverse.
Qu’avez-vous pensé, justement, en tant qu’avocat défenseur des libertés, du débat autour de la réédition des pamphlets antisémites de Céline ?
J’ai trouvé ce débat extrêmement révélateur, et pas pour le meilleur. D’abord, dans l’autorisation que s’est donnée je ne sais quel fonctionnaire de convoquer un éditeur pour lui demander des « garanties ». On ne sait s’il faut en rire ou en pleurer. Ensuite, dans l’idée que ces « garanties » pouvaient résulter de la multiplication de notes fabriquées par des historiens. Et qui les choisira ? Qui contrôlera les historiens ? Il n’y a pas si longtemps nous en avons vu un qui assimilait Merah à un disciple de Durkheim tué au combat pendant la Grande Guerre, motif pris d’un appareil méthodologique absolument burlesque. Cette idée de la neutralité de l’historien me paraît fort niaise, tout comme me parait blâmable cette autre idée, qui décidément me paraît correspondre en ce moment à une conviction tout à fait générale, que le lecteur serait à priori un pauvre type incapable de s’informer et de réfléchir par lui-même.
Mais il y a plus grave. Dans ce débat, ce qui m’a frappé, c’est l’appel sourd, implicite, insistant, à la cécité collective. La question de savoir comment un grand écrivain peut aussi avoir été un antisémite abject ne sera pas posée. L’art est au-dessus de tout. Les raisons de toutes natures qui ont conduit aux rafles et aux déportations ne seront pas élucidées. Censurons ! Oublions ! Nous resterons le pays des droits de l’homme et du vin de Bordeaux. C’est bien commode. C’est le même réflexe au fond qu’à propos de la déchéance de nationalité ou de l’interdiction de consultation des sites djihadistes. Cachons ces horreurs que nous ne saurions voir parce qu’elles abîment l’image que nous nous faisons de nous-mêmes. Retranchons de la superbe communauté française ces gens qui la défigurent. N’allons pas voir ce qu’ils racontent entre eux, nous risquerions de nous interroger sur les causes.
Vous aviez en son temps défendu le film Baise-moi de Virginie Despentes, classé X et donc interdit de distribution dans les salles de cinéma : pouvez-vous nous rappeler ce qui vous avait conduit à le faire ?
Je l’ai défendu pour bien des raisons. La première était qu’il me paraît mal venu de fermer les yeux sur « ce qui ne va pas », et dont le film, malgré ses imperfections, entendait parler. Mais la seconde était l’ineptie conceptuelle de la décision rendue par le Conseil d’État. Elle se fondait d’abord sur cette idée que ce film était intrinsèquement dangereux. Mais où va-t-on si l’on répudie la distinction entre la représentation et l’action ? Censurera-t-on Le Parrain parce qu’il peut entraîner des esprits faibles à vouloir se fabriquer une carrière dans la Mafia, ou L’Honneur d’un capitaine parce qu’il peut disposer nos officiers à l’usage de la torture ? On n’est pas plus bête.
Beaucoup de vos livres sont consacrés à des figures, dont certaines sont historiques (La Chanson de Passavant sur Patrocle Passavant des Baleines, Je ne pense plus voyager sur Charles de Foucauld, Inigo sur Ignace de Loyola, L’Obéissance sur Anatole Deibler, bourreau de Paris) : y a-t-il un lien entre tous ces hommes, en dehors de vous ?
Parmi les figures dont vous parlez, certaines sont en effet réelles et d’autres imaginaires. Cela n’a pas d’importance. Monte Cristo m’est toujours apparu plus réel qu’aucun gouverneur de la Banque de France. Nous faisons des personnages de notre vie, le plus souvent, des êtres imaginaires, puisqu’il est vrai en particulier, comme disait Proust, que « notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres ». J’ai été plus et mieux accompagné par certains morts, Ignace ou Pascal, ou Apollinaire, que par des vivants. Le seul mystère, me disait un ami jésuite, précisément, c’est celui des destinées. C’est celui-là qui me passionne, dans ce continuum entre le présent et le passé, la vie et la littérature.
Je conçois d’abord la littérature comme une activité parfois épuisante, mais toujours profondément réjouissante. Il n’y a pas à mes yeux de manière plus agréable de passer sa vie. Je ne sais plus qui disait que Flaubert avait passé son existence à s’en plaindre simplement pour se faire pardonner d’avoir choisi la meilleure part. Et dans cet exercice de vie intégrale, tout arrive tour à tour, on se regarde, on s’oublie, on admire, on déteste, on recherche, on s’aveugle, et surtout l’on ne cesse jamais d’attendre cette lumière qui vient, et qui prend à son heure les couleurs du crépuscule ou celles de l’aube.
Avez-vous un livre de chevet ?
Je n’ai pas un livre de chevet, mais une trilogie. L’ordre varie parfois dans la pile : Les Pensées de Pascal, Les Méditations de Guigues le Chartreux, qui est l’un des plus beaux textes du Moyen Âge, et Alcools d’Apollinaire. Sur la longue période, les deux derniers livres peuvent entrer et sortir, mais Pascal reste toujours là. Je l’aime pour ce qu’il dit de Dieu et des hommes, pour son incroyable réalisme, pour sa phrase, et aussi pour le regard qu’il jette sur la politique. Pascal est une figure nationale, et pourtant, de tous les auteurs dont les Français aiment à se réclamer, il est pourtant de très loin celui qui leur est le plus profondément étranger. Ni les apparences ni les institutions ne l’impressionnent. Les Français se croient sceptiques et sont de grands gobeurs, des lois du royaume jusqu’aux principes républicains. Ils se font sur leurs ministres, sur la politique et sur eux-mêmes, des illusions que Pascal ne partage en rien. Le reproche, à mes yeux justifié, qu’il adresse à Montaigne, c’est de s’arranger de tout, moins par paresse que par aveuglement. Ce météore en costume noir paraît tomber de la lune comme le Cyrano de Rostand. Et si ses inquiétudes sur la grâce rappellent un autre auteur, ce n’est pas un Français mais le Defoe de ce Robinson qui lui ressemble et s’interroge sans cesse sur le sens de son naufrage. Pascal est l’irremplaçable compagnon d’une vie, si du moins on veut la vivre les yeux ouverts.