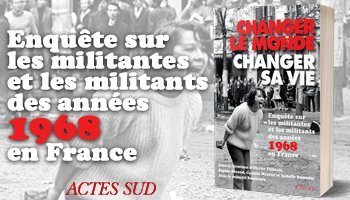André Markowicz : « Il se trouve que je passe ma vie à traduire »
Dans un long poème en décasyllabes paru en mars dernier, L’Appartement, André Markowicz évoque pêle-mêle son travail, ses souvenirs d’enfance, le long combat juridique mené aux côtés de sa compagne Françoise Morvan après qu’elle fut attaquée pour la publication d’un livre sur le nationalisme breton, et bien sûr l’attachement à son appartement familial de Saint-Pétersbourg. Son travail, c’est celui d’un traducteur reconnu et passionné, qui a achevé en une décennie la traduction intégrale des œuvres de Dostoïevski, qui a traduit Tchekhov, Gogol, Shakespeare, mais aussi des poèmes chinois.
À partir de l’appartement de votre grand-mère, vous évoquez, dans un long poème, comme dans un souffle, des souvenirs d’enfance, votre mère et vos grands-mères, votre travail de traducteur, un procès énergivore comme une maladie… Pourquoi le choix de cette forme et de cette versification pour écrire sur votre vie ?
Ce vers est en lui-même une image du texte. C’est un décasyllabe, très ancien vers français, mais c’est un décasyllabe spécial, parce qu’il est « blanc » (c’est-à-dire qu’il ne rime pas) et qu’il est compté non seulement sur le nombre de syllabes mais aussi, avec, en plus, des variations, sur le modèle du vers anglais, allemand et russe qu’on appelle le «pentamètre iambique ». Et ce pentamètre iambique, qui est le vers de Shakespeare, ou bien celui du théâtre romantique allemand, ou le vers du Boris Godounov, n’existe pas dans la tradition française – même si j’ai traduit Shakespeare et Pouchkine en le respectant. Et donc, il est entre deux traditions, entre deux cultures, il est et il n’est pas. Il est entre les deux, entre deux rives, en quelque sorte.
Vous évoquez la barrière de la langue à plusieurs reprises. Celle que vous avez ressentie face à votre mère russe, lorsque vous faisiez une erreur en lui parlant dans sa langue ; ou celle ressentie lorsqu’on a pu vous complimenter sur votre russe. Quelle place donnez-vous à cette barrière, et peut-être à la vol