Michel Hazanavicius : « Entre parodie et pastiche, je vois une grande différence »
Coupez ! est le huitième long-métrage de Michel Hazanavicius et le neuvième si on ajoute un film essentiel réalisé pour la télévision, La classe américaine. Essentiel parce qu’il s’agit d’un premier long et qu’il imprime dès le départ un mode opératoire qu’on retrouvera tout au long de sa filmographie : l’art du détournement. Michel Hazanavicius marque en effet la comédie française par sa façon de jouer avec les codes du cinéma, dans un pastiche plein de panache tant ses films sont des hommages constants au cinéma. Son dernier film se situe à ce titre sur un tournage. L’occasion de montrer le cœur de la machine, la fabrication d’un film au croisement de la mécanique et du vivant, entre la maîtrise de la fiction et l’aléatoire du réel. Le réel agissant ici évidemment comme autant d’éléments de gags contre le bon déroulement du scénario. Ajoutons la cohérence dramaturgique de la structure du film qui démarre par le film dans le film puis zoom arrière dans le temps nous permettant de revoir le film depuis les coulisses et le travail de l’équipe. Les gags prennent une nouvelle dimension d’une partie à l’autre, à mesure que se redévoilent les souvenirs de la première partie. En effet, la première partie de Coupez ! nous montre la réalisation d’un film de Zombies – une série Z, fauchée – avec ses règles, ses codes, et son hors-champ mortel. Et la deuxième partie nous offre le hors-champ du film de Zombie. Mortellement drôle. Le film sort le 17 mai. Il fera la veille l’ouverture du festival de Cannes. Pourvu que le réel vienne perturber la fiction festivalière. QM
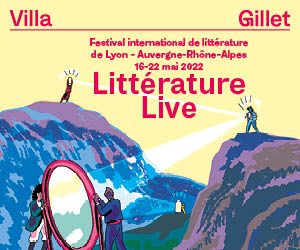
Coupez est votre huitième long-métrage, et une bonne moitié de vos films sont des comédies. Quel est votre rapport à ce genre ? Quels sont les cinéastes qui vous ont marqué ?
J’ai d’abord un rapport de plaisir en tant que spectateur – lorsque j’ai le choix, je vais facilement vers la comédie. Je trouve que c’est un genre extrêmement noble que j’essaie de fabriquer avec beaucoup de sérieux. Ce n’est pas
