Cristèle Alves Meira : « Je veux filmer la magie comme contre-pouvoir »
Avec son premier long métrage présenté lors de la dernière Semaine de la critique à Cannes, Cristèle Alves Meira continue son portrait teinté de réalisme magique d’un Portugal contemporain marqué par les vagues de migration et baigné de croyances dans les forces occultes. Salomé n’a pas dix ans, passe l’été avec sa grand-mère qui pratique des rituels païens dans le secret de sa maison et découvre qu’elle a hérité de son don. Dans ce portrait amoureux d’une relation entre deux figures féminines séparées par deux générations, la réalisatrice réécrit sous forme de fable dramatico-comique les souvenirs des sensations de son enfance. R.P.
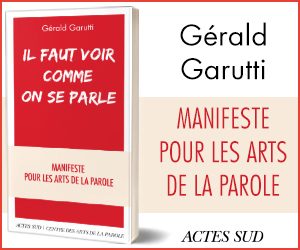
Alma viva s’ouvre par l’œil d’une petite fille derrière un rideau. Elle observe un rituel magique d’accompagnement d’un mort vers l’au-delà. Pourquoi nous faire entrer dans le film par une scène qui nous est montrée et masquée à la fois ?
Avec Rui Poças, le chef opérateur, nous avons beaucoup réfléchi à ce que nous souhaitions montrer. Nous aurions pu mieux éclairer, faire une ouverture plus grande. Cet œil à travers la serrure nous fait entrer à hauteur d’enfant dans un espace très intime qui nous est interdit. En fait, je tenais à ce que l’on ouvre sur un mystère, sur quelque chose qu’on ne comprend pas tout à fait. Je voulais absolument qu’on voie la flamme de la bougie, qu’on entende des sons, qu’on voie des matières, qu’on soit dans des sensations mais sans savoir vraiment ce qui se passe. J’aime le doute que cela crée chez le spectateur. Ce n’est qu’au fil du film, par bribes, en revenant dans cet espace restreint, étrange, occulte, où les esprits peuvent circuler que l’on reconstruit ce qui s’y passe. C’est très propre au domaine des croyances : on ne sait pas tout à fait à quoi on a à faire.
Comme le personnage de Salomé, la fillette qui tient le rôle principal, vous êtes originaire du Portugal où vous avez passé tous vos étés depuis l’enfance. Ces croyances font-elles partie de votre vécu ?
Oui, c’est très familier. À la maison, il y a toujours eu beaucoup de prières, d’histoires de sorcières, dans un mélange religieux et très païen. Le film va chercher des rituels que j’ai pu observer dans ma famille ou chez des voisines. Les rituels que je reconstitue n’appartiennent pas forcément à cette région. Même si je ne suis pas dans une démarche anthropologique au vrai sens du terme, je me suis beaucoup documentée pour écrire.Dans les familles portugaises, on vit encore avec les morts. Le lien aux funérailles, à la veillée des corps est resté très fort. Enfant, je redoutais ce rituel qui me fascinait pourtant. Ça crée une forme de peur autant qu’une excitation. Cette image d’une enfance tourmentée très solitaire qui doit se confronter à ses peurs nocturnes, à ses fantômes, à la brutalité des adultes me vient de Cría Cuervos de Carlos Saura, qui a énormément compté pour moi.
Il était important pour moi qu’il y ait autour de cette femme morte un mélange de générations. On apprend à vivre avec cette morte que l’on tarde à enterrer : on fait un pique-nique autour, même les bébés lui rendent visite, on chasse les mouches sur son corps… Je montre le cadavre, mais les choix du cinéma, de cadrage, d’éclairage, vont vers quelque chose de beau, comme ce voile traditionnel qu’elle porte. Nous nous sommes posés des questions très techniques sur l’état de décomposition du mannequin, sur la nuance blafarde de son teint. Il ne faut pas oublier qu’elle est vue à travers les yeux d’une petite fille. J’ai cherché dans beaucoup de plans cette superposition du vivant et de la mort.
C’est toute la signification du titre qui est venu très tôt : la grand-mère reste une âme vivante. Dès les premiers résumés, j’étais dans le récit de l’âme d’une grand-mère empêchée de partir à cause de sa pierre tombale qu’on ne paie pas et du déshonneur fait à sa sépulture. Quand Laurent Lunetta est arrivé dans la dernière année d’écriture, il m’a proposé d’appeler le film Bruxa qui veut dire sorcière. Nous avons tourné avec ce titre, avant de revenir au titre original, ce dont je suis très heureuse. Salomé croit vraiment que les esprits ne sont pas loin et qu’il y a une potentielle communication entre le visible et l’invisible. Cette petite fille nous propose d’aller au-delà du rationnel, de voir le monde autrement. Il y a une certaine poésie de la spiritualité dans son regard que je vois comme une forme de résistante à une rationalité très arrogante à mes yeux. Ce que je veux filmer, c’est la magie prise comme un contre-pouvoir, une façon de ré-enchanter ce monde qu’on nous vend comme désenchanté pour mieux nous contrôler.
Comment vous êtes-vous documentée sur ces questions de sorcellerie ?
J’ai lu des ouvrages sur les spirites, notamment ceux d’Allan Kardec, des anthropologues qui ont travaillé sur la sorcellerie comme Les Mots, les morts, les sorts de Jeanne Favret-Saada. L’essai de Mona Chollet Sorcières, la puissance invaincue des femmes est paru alors que j’avais déjà terminé ma première version du scénario en 2017. Un anthropologue franco-portugais a écrit son mémoire sur sa grand-mère qui était medium : mon personnage est inspiré de son livre. Miguel Montenegro, anthropologue portugais lui aussi, compile dans Les Bruxos, des témoignages de personnes ensorcelées. C’est de là que j’ai tiré la scène de la grand-mère qui vomit de la boue et des cheveux. J’ai rencontré des praticiens de toutes sortes, des mediums, des gourous… ils ne s’appellent jamais sorcières ou sorciers, c’est un nom tabou. Souvent, on ne les désigne pas par une appellation mais par leur prénom. Chacun va chercher des références, des rituels un peu partout. J’ai fait de même : Alma viva est ma propre constellation, mon sanctuaire. Par exemple, j’ai emprunté à des cultes brésiliens la figure de Saint Georges, qui n’est pas du tout priée dans cette région portugaise. Sa représentation aux côtés d’un dragon montre visuellement ce combat contre le Mal. Nous avons construit pour le film un calvaire qui lui est dédié. Il s’est tellement bien intégré dans le territoire qu’il a été béni à la fin du tournage. La fiction et la réalité se sont mêlées. Ce lieu de cinéma est devenu un lieu de culte.
La relation de transmission entre une fillette et sa grand-mère donne une dimension de conte initiatique au récit. Elle permet également de montrer deux corps féminins qui ne se définissent absolument pas par le regard des hommes.
Salomé se confronte au corps de sa grand-mère de manière très triviale. La simple image des pieds ou des mains qui lavent ce corps raconte déjà tout le hors champ de ce qu’a pu être sa vie. Avant de le faire mourir, je voulais montrer ce corps chaud, vivant. Sa poitrine déborde tant elle est imposante. Ester Catalão qui joue Avó est originaire de cette région et n’est pas comédienne professionnelle. Elle est transgressive dans le sens où elle n’est pas du tout dans le cliché de la femme portugaise de cet âge-là, discrète et endeuillée. Ma rencontre avec elle a libéré beaucoup de lignes du scénario. Elle était fière de montrer sa poitrine au point qu’elle s’est fait faire son premier tatouage à 78 ans spécialement pour la scène où on la voit torse-nu. Sa fierté, c’est son pouvoir. Je lui dois beaucoup, je n’aurais pas osé aller si loin si elle ne m’avait pas offert cette liberté.
Comment avez-vous mené le casting local ?
Je tenais à ce qu’il y ait des animaux, des gens de toutes générations originaires de cette région de montagne du Portugal, le Trás-os-Montes où règne une exubérance, une énergie très particulière. Comme tous les décors étaient dans mon village, j’ai commencé le casting par là. C’était très amusant de mettre en scène des situations de jeu, des improvisations avec des gens qui m’ont vu naître. J’ai lancé un appel à casting dans les villages environnants pour faciliter les déplacements. J’ai mélangé ces acteurs locaux avec des acteurs franco-portugais, comme Arthur Brigas qui joue l’oncle Joaquim. Il n’est pas facile de trouver des hommes de son âge qui ont la curiosité de faire du cinéma et surtout le temps. Il est agent immobilier dans la vie et m’a permis d’ajuster son personnage, qui à l’écrit était plus caricatural, macho, roulant des mécaniques. J’adore les hommes portugais, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire… c’est pour cette raison que j’ai fait surtout des portraits de femmes. Elles sont transgressives chacune à leur façon, elles sortent du cadre. Dans tous ces personnages, il y a beaucoup de ma mère et de mes tantes. Elles sont brutes, assez vulgaires, mais je les trouve très belles. En tant que française née de parents portugais, j’aime cette ruralité et je trouve qu’il n’y a pas à s’en cacher. Mes parents ont voulu à tout prix que l’on rentre dans le moule, que l’on s’intègre à un modèle au point de ne pas assumer d’où on vient. J’ai fait ce film pour prendre la place qu’ils n’ont pas voulu prendre parce qu’il fallait s’adapter. J’ai envie de m’inscrire dans ces traditions, dans ce paysage et de les voir comme une force et non comme un poids. La honte d’avoir quitté son pays est forte et on préfère nier les raisons de cette immigration. Ma génération a besoin de se relier à cette histoire et de faire que cette mémoire reste vive.
Alma viva fait le récit fantastique d’événements occultes. C’est également un portrait de groupe réaliste de l’émigration au Portugal à travers une famille et un village.
Le point de départ du film est un élément autobiographique : au moment de la mort de ma grand-mère, j’ai vu mes oncles et tantes se disputer au sujet de sa pierre tombale, exactement comme dans le film. Ma grand-mère est restée deux ans sans sépulture. J’ai fait ce film pour comprendre ce qui avait poussé ma famille à autant de violence et à déshonorer la volonté de ma grand-mère qui était d’avoir un tombeau, qui aimait me montrer sa « maison d’après la vie ». En écrivant ce film, la fiction l’a emporté et les oncles et tantes de Salomé ne sont pas du tout les miens, mais ça m’a permis de questionner la réalité de ces familles portugaises divisées entre ceux qui restent et ceux qui partent à l’étranger, en France, en Allemagne, qui s’enrichissent beaucoup et reviennent construire de grandes maisons, des piscines, roulent dans de grosses voitures. Leur façon d’exhiber les richesses dont ils ont manqué par le passé a tendance à favoriser le complexe d’infériorité de ceux qui restent. J’ai essayé de pointer avec humour et tendresse la réalité sociologique de ces écarts familiaux. Fatima est pleine de contradictions : elle reproche à ses frères et sœurs d’avoir dû rester pour s’occuper de leur mère après leur départ, mais on sait qu’elle a une raison plus secrète de rester au village, qui est sa relation amoureuse avec sa voisine. C’est souvent comme ça dans la vie, on reproche aux autres ce qui relève de nos raisons intimes. Aïda vient avec son parfum, c’est une façon de se racheter une culpabilité d’être partie. J’ai ce souvenir de ma mère qui couvrait sa mère de cadeaux chaque année. Quand les Portugais de France débarquent dans les villages l’été, ça parle français partout, ça crie fort. On voit une dualité criante entre la vieille génération sur des mulets et les jeunes en quad, qui pêchent à la dynamite.
Vous filmez justement cette pratique dans un plan totalement explosif qui intervient après la première séquence mystérieuse, sombre, où on peinait à savoir ce que l’on voyait. Le film joue énormément de ce choc entre immatériel et concret.
J’ai choisi la pêche à la dynamite pour des raisons documentaires parce qu’elle est très pratiquée. C’est aussi une image crue de la mort qui se passe de commentaire ou de dialogue. J’y vois enfin une portée symbolique, très biblique, avec cette pluie de poissons qui peut sembler miraculeuse alors qu’elle résulte d’une brutalité faite à la nature. J’aime ces multiples possibilités d’entrée dans une image, très concrète et plus métaphorique. Ce motif était présent dans le scénario, mais c’est au montage avec Pierre Deschamps que l’on a travaillé sur des contrastes, des chocs entre les plans pour qu’ils prennent cette puissance. La pêche fait l’objet d’une image unique alors que nous avions tourné toute une séquence avec un groupe de jeunes au cours de laquelle Salomé lançait elle-même la dynamite. J’ai le sentiment, même si cette scène n’est pas dans le film, qu’on sent pourtant son existence, comme quelqu’un qui a perdu un membre ressent des douleurs fantômes. J’ai confiance en la force d’une image.
Un autre de ces chocs tient dans le fondu enchaîné entre deux plans : le gros plan sur le visage de la grand-mère morte qui se fond dans le plan large de l’incendie sur les collines donne le sentiment que c’est de la bouche de la défunte que naît l’embrasement de tout le village.
Nous avons cherché longtemps comment faire comprendre que c’est la grand-mère qui hante le village et qui déclenche la malédiction. D’autres personnes plus rationnelles ne verront pas ce lien de cause à effet car on peut y percevoir aussi la description très réaliste du Portugal qui brûle l’été. J’ai choisi pour la scène de l’incendie des images d’archive que j’ai mêlées au tournage dans le village grâce à des effets spéciaux. Cela donne un ancrage presque documentaire. Pourtant, au moment où les pompiers rassemblent tous les animaux du village pour les sauver, nous avons cherché quelque chose de léger dans la musique, nous pensions beaucoup à Jacques Tati en montant cette séquence. Cela m’amusait de confronter la réalité tragique de l’évacuation d’un village menacé par les flammes et le basculement vers la fable que convoque l’accélération désordonnée des funérailles. Avec Laurent Lunetta, le co-scénariste, nous avons imaginé ce déchainement des passions qui devient excessif avec les jets de pierres des villageois sur la procession de l’enterrement, comme dans une grande tragédie. J’aimais le choc des tonalités, que l’humour embrasse le drame tout en restant très réaliste dans les images. J’aime beaucoup ce mélange dans Memory of murders de Bong Joon-ho, même si on est très loin d’Alma viva. Il arrive que des personnages chutent et apportent de la drôlerie dans des scènes très sérieuses.
Ce choc des tonalités est rendu possible par la très large palette d’expressions de Salomé, ce qui tient au scénario, mais aussi à la performance de l’actrice Lua Michel. Avez-vous écrit des scènes directement en vous inspirant de sa personnalité ?
Il est vrai que je la connais très bien puisqu’elle est ma fille. J’ai écrit la séquence du twerk en effet en la voyant un été imiter ma nièce et mes cousines s’entraîner à cette danse dans le village. Juste avant, sa grand-mère lui annonce d’une façon solennelle qu’elle a le corps ouvert aux esprits de l’au-delà. J’aimais passer tout de suite à quelque chose de plus quotidien, plus populaire. Mais je tiens à dire aussi que Lua a une maturité impressionnante. Je la consultais souvent parce qu’elle avait une compréhension plus intuitive que moi des situations. Dans sa scène avec son oncle au moment du jet de pierres, elle n’arrivait pas à dire tout le dialogue : il était long, il faisait très chaud, nous étions en retard… Je lui ai demandé ce qu’elle pensait que son personnage devait faire. Elle a condensé la scène à trois phrases : elle prend son oncle dans ses bras et le rassure sur l’amour que lui portait sa mère. Elle avait raison d’aller à la sève des choses, de supprimer ce qui était dans l’effet et de faire confiance à un geste à la fois plus simple et très fort qui est de l’arrêter en pleine rue. Elle a une maîtrise de son corps comme une intelligence émotionnelle dans les prises qui la rend capable de passer d’un registre à un autre. C’est assez inexplicable…
Le tournage d’Alma viva a été reporté d’un an en raison du Covid-19. Vous avez dans cette période tourné deux courts métrages, Invisel Herói et Tchau Tchau. Ces trois films sont très poreux les uns avec les autres, en termes de casting, de thématiques et fonctionnent comme un continuum bien plus que comme des œuvres distinctes.
J’irais même plus loin : c’est le besoin de raconter l’histoire d’Alma viva qui m’a conduite de la mise en scène de théâtre au cinéma. N’ayant pas fait d’école, il me paraissait naturel de commencer par des courts métrages. J’en ai tourné quatre en écrivant Alma viva, ce qui m’a permis de préparer le terrain au Portugal, de créer une famille de cinéma entre la France et le Portugal, de faire mes premiers pas dans les festivals… et de travailler avec des acteurs qu’on retrouve, comme Duarte qui est dans Invisivel Heroi ou Ana Padrão qui joue dans Champ de vipères.
Tchau tchau s’est monté pendant le confinement en mars 2020 grâce à un producteur, François-Pierre Clavel de Kidam, qui m’a fait confiance sur une simple conversation au téléphone. C’était une première expérience avec ma fille qui permettait de réfléchir ensemble au deuil. C’était un test sur la possibilité qu’elle travaille avec ses parents puisque son père, chef opérateur sur ce court, est conseiller artistique sur Alma viva. C’était bien pour tester de quoi elle était capable et voir comment on communiquait. J’en ai vu les limites : sur Alma viva, j’ai cherché un intermédiaire. Je ne voulais pas que le rapport de pouvoir ou l’attente du résultat n’abiment notre relation. Manon Garnier a été coach sur le tournage et prenait la parole pour moi parce qu’une mère est forcément… énervante ! Dans Tchau Tchau on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, si mon père est réellement mort. La question de la limite entre le documentaire et la fiction, le besoin de croire sont au cœur de mon désir de faire du cinéma. La crédibilité est une chose à laquelle je tiens beaucoup. J’essaie de dégager les artifices et de créer le trouble.
Le film est déjà sorti au Portugal. Quel souvenir gardez-vous des projections auxquelles vous avez assisté ?
L’image qui me reste, ce sont les visages de ces femmes de mon village qui découvrent le film. On pénétrait un espace interdit, tellement intime, elles se voyaient et c’était très beau de voir dans leur regard qu’elles étaient impressionnées. Être choisie pour représenter le Portugal aux Oscars a également été très inattendu. C’est la première fois qu’une portugaise émigrée est choisie pour représenter le Portugal aux Oscars, c’était vraiment très fort pour moi. Cela représente une reconnaissance de l’histoire de mes parents.
Alma Viva, de Cristèle Alves Meira, en salles depuis le 12 avril 2023.
