David Thion et Marie-Ange Luciani : « On fait un mauvais procès au cinéma d’art et essai »
Anatomie d’une chute est le quatrième long métrage de la réalisatrice Justine Triet qui signe aussi sa deuxième collaboration avec deux producteurs de deux sociétés différentes qui partagent le goût de la fidélité à leurs auteurs et celui d’une ligne exigeante. On doit à David Thion et aux Films Pelléas les films de Danielle Arbid, Axelle Roppert, Serge Bozon ou encore certains films de Mia Hansen-Løve. Avec les Films de Pierre, fondés par Pierre Berger, Marie-Ange Luciani a suivi le travail de Robin Campillo depuis Eastern Boys. En signant un drame policier, Justine Triet remet sur le métier son obsession du couple contemporain, du poids du domestique et de la difficulté pour chacun de maintenir son accomplissement individuel. La mort brutale du mari met sur la place publique des questions intimes et interroge ainsi la frontière entre ce qui se construit à deux et ce que la société fait peser comme rôles implicites dans les liens conjugaux.
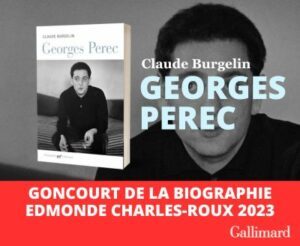
Ce film de procès a aussi donné lieu à un tribunal populaire qui a vivement réagi au discours de la cinéaste au moment de recevoir la Palme d’or. Elle y témoignait d’inquiétudes sur une dérive du pouvoir actuel : glissement autoritaire face aux manifestations contre la réforme des retraites ; tendance récente à remettre en cause l’exception culturelle au profit d’une politique qui favoriserait de plus en plus la rentabilité des œuvres et des structures.
Marie-Ange Luciani et David Thion évoquent leur réaction face à cette polémique, leur joie de voir le film récompensé au Festival de Cannes, leur rôle artistique et financier dans la fabrication du film et leur regard sur les changements qui touchent la production cinématographique suite à la crise du covid et à la place grandissante des plateformes de streaming. RP
Comment avez-vous appris que Anatomie d’une chute avait la Palme d’or ?
Marie-Ange Luciani : Nous avons reçu un texto nous demandant de revenir à Cannes le matin de la cérémonie de clôture à 10h52.
David Thi
