Ana Vaz : « Je veux faire un cinéma du vivant »
En se promenant dans Brasilia où elle est née, l’artiste Ana Vaz a observé un nombre croissant de présences animales dans la capitale brésilienne, vivants aussi bien que morts. Dans cette symphonie d’une grande ville librement inspirée de La Cosmopolitique des animaux de la philosophe Julia Fausto, elle traverse Brasilia à rebours de son Axe Major, dans une nuit qui n’en finit pas, augmentée par la nuit américaine dans laquelle elle plonge ses images tournées en pellicule. Dans ce voyage spectral hanté par la musique de son père, le compositeur Guillerme Vaz, elle questionne notre rapport intime et politique à l’Animal. RP
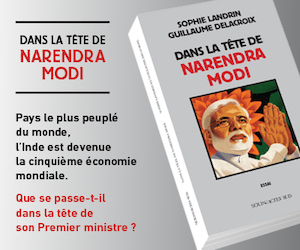
Il fait nuit en Amérique traque des animaux sauvages qui s’immiscent dans la ville de Brasilia. On ne peut s’empêcher de se demander comment vous les avez découverts. D’autant que se crée un subtil jeu de regard qui donne un sentiment de grande proximité avec eux.
Dans les situations où ces animaux sauvages arrivent en ville, les riverains appellent la police environnementale qui vient les secourir. C’est en faisant des rondes avec eux que j’ai pu filmer un grand nombre d’espèces. Il n’était évidemment pas question de déplacer des animaux pour les emmener en ville afin de les filmer : j’ai donc travaillé dans le sens du montage pur en créant des raccords de regard entre eux et nous. Quand les soigneurs du zoo se tournent vers les animaux, je ne sais plus qui regarde qui, qui est captif de cette situation. J’ai eu progressivement envie de chercher à comprendre les vétérinaires, les militaires de la police environnementale et cela a changé ma façon de voir le monde. J’ai fini le film avec bien moins de réponses que je n’en avais avant de le commencer. Aujourd’hui, dans la plupart des zoos au Brésil, 90% des espèces sont rescapées : les zoos deviennent des camps de réfugiés. Cela m’a questionnée qu’une institution directement liée au pouvoir colonial qui chassait jadis les animaux pour les exposer en signe de domination devienne soudain un endroit de soin. Il me semble que nous sommes captifs de quelque chose de plus large, de tout un système dans notre monde qui tend à figer le mouvement.
L’une des vétérinaires emploie à propos des animaux un type de vocabulaire qui peut faire penser aux migrations humaines. Ce lexique opère une autre forme de renversement. D’autant que vous confrontez les gestes des soigneurs à des photos en noir et blanc datant des origines de leur lieu de travail.
Même si j’ai filmé peu après le confinement, le retour de ces animaux en ville n’est pas dû au retrait de la présence humaine de l’espace urbain. La raison est que leur milieu de vie est détruit à une vélocité très intense. Ils deviennent des êtres sans territoire qui, en cherchant un refuge, trouvent les dangers de la ville. Au lieu d’essayer de déconstruire le pouvoir politique enfoui dans la ville, je voulais adopter la perspective de ces animaux qui ne sont pas considérés comme des êtres politiques. Les photos que vous évoquez font partie d’une archive un peu informelle à laquelle j’ai eu accès en côtoyant le personnel du zoo. On y voit l’épopée de l’édification de ce lieu à partir de 1955, la manière dont les animaux sont arrivés dans des cages très improvisées au milieu de la savane. Le projet du zoo était moderne architecturalement : il s’organisait autour d’environnements qui se faisaient passer pour naturels, dont on ne voyait pas les barrières. À ce moment, où la ville de Brasilia n’était même pas construite, il a été procédé à un gigantesque terrassement pour retirer toute la faune et la flore. C’est un geste habituel de la colonialité et de la modernité que de décréter : à partir de là commence la ville. J’étais déjà en mixage quand j’ai décidé d’intégrer ces images fixes en noir et blanc. Elles forment comme un flash-back au centre du film, qui permet de s’adresser à l’histoire de la naissance de Brasilia, prise entre notre présent et le projet messianique à l’origine de sa construction. L’utopie du projet de cette ville a rapidement été recouverte par la dictature qu’évoquent les tambours militaires que l’on entend au début. Quelque part, je me demande si le zoo ne serait pas la synecdoque de la ville : un système de captivité à l’infini. J’entends tisser une relation avec ces êtres qui sont en pleine fuite de la violence immense de la destruction du cerrado brésilien, ainsi qu’avec la faune et la flore menacées par les projets de conquête et d’intoxication par la monoculture. La culture du soja qui est partout dans cette région. Mais j’entends aussi la monoculture dans le sens colonial : l’uniformisation, l’extermination de formes de diversités de vie. Je voulais qu’Il fait nuit en Amérique nous plonge dans l’incapacité de notre époque à percevoir clairement ces relations. C’est de là qu’est venu le rapport du film à l’obscurité.
Il fait nuit en Amérique s’enfonce en effet dans une nuit qui semble sans fin et qui donne à ressentir une épaisseur matérielle de l’image.
Cette épaisseur est concrète. Elle provient de ce que nous avons travaillé avec de la pellicule périmée. Cela fait une quinzaine d’année que ces bobines destinées à des films publicitaires s’abimaient dans de mauvaises conditions de préservation. J’aime l’idée que la pellicule de mon film fasse l’archéologie de la matière analogique en elle-même. J’ai utilisé pour tourner le procédé de la nuit américaine alors que c’est théoriquement impossible avec de la pellicule ancienne. Ces plans sont comme des tirs dans la nuit : je ne savais quelles images apparaitraient au développement. L’épaisseur dont vous parlez vient aussi du son de la ville : j’ai tourné en grande partie en son direct, depuis le dernier étage d’un immeuble. À partir d’une telle hauteur, le son résonne énormément, il est comme mangé par le bruit de la ville… Au mixage, nous avons eu beaucoup de mal sur certaines prises à faire ressortir le cris des animaux car le bruit blanc de la ville prenait à lui seul beaucoup de place. Les premiers plans ont été tournés à São Paolo, au dernier étage de Copan, l’un des plus hauts immeubles de l’une des plus grandes villes d’Amérique du sud avec ses vingt millions d’habitants. Je voulais regarder un reste de forêt de São Paolo Jaragua, qui fait subsister une ceinture verte autour de cette ville. Je ne savais pas que ce plan-test resterait au montage. C’était curieux de commencer un film dans ce bâtiment qui incarne toute la pensée communiste de Monsieur Niemeyer pour aller ensuite dans la ville qu’il est parti construire en abandonnant Copan. En regardant Jaragua depuis cet étage élevé, je me suis dit que le contrechamp devait être d’aller filmer à Jaragua. Le film m’a paru urgent très soudainement. Depuis cette lisière entre l’espace sauvage et urbain, j’ai eu envie de raconter comment la construction des villes au XXe siècle s’est faite autour de cette délimitation nouvelle. À partir de la révolution sanitaire, les animaux, mêmes les bêtes de travail comme les ânes ou les cochons, sont retirés des villes.
La ville de Brasilia s’est construite sur la conviction qu’avant il n’y avait rien alors qu’il n’y avait simplement rien d’humain…
Dire qu’avant, il n’y avait rien, c’est estimer que tout ce qui est non humain n’est pas vivant. La politique brésilienne dit par exemple que l’Amazonie est un vide géographique et démographique. Mon œuvre tourne autour de cette violence-là, de cette insistance à faire du geste de terra nullius une utopie. Brasilia y fait figure de symbole évident parce que j’y suis née et parce qu’elle incarne le centre direct du pouvoir tout comme ce désir de colonisation et de reconquête du pouvoir.
Il fait nuit en Amérique opère une disjonction entre les corps et leur voix, ce qui ajoute à l’aspect spectral et fait tirer le film vers la science-fiction.
L’enregistrement crée toujours en soi le double d’une présence fantomatique. Le film décide de ne jamais voir une personne en train de parler en temps réel, de donner de la place au son et à l’image comme des éléments indépendants qui ne sont pas nécessairement appelés à être synchrones. Le synchronisme au cinéma est un artifice : il nécessite toujours d’être recréé. Mon film parle de cadavres d’animaux, mais il existe quelque chose de spectral à un niveau plus vaste. Le corps humain n’est pas ici le corps référence du monde.
Votre utilisation du ralenti donne parfois la sensation que nous hallucinons les images que nous voyons.
Les capibaras, par exemple, sont partout dans la ville de Brasilia. Ils s’approprient les espaces de la ville, ils sont en train de pousser les frontières de ce que la cité accepte. La notion du rythme, de la vitesse du film a à voir avec la nécessité de regarder intensément. C’est pour cette raison que j’ai par moments utilisé le ralenti – notamment avec le fourmilier – tout en conservant une confusion sur ce qui nous semble ralenti entre l’image et le mouvement de l’animal. La relation avec l’humain est toujours construite dans des termes de captivité, ce qui fige par définition les mouvements qui sont pris dans des architectures de soin qui sont aussi des architectures de capture. On est toujours dans une lisière très tendue entre violence et tendresse, soin et prédation. C’est comme si le film était une traversée des genres cinématographiques : d’abord un récit dystopique avec la forme d’OVNI moderniste du bâtiment du Parlement vers lequel on se dirige, puis un polar avec la police environnementale, suivi d’un documentaire animalier pour finir sur une fable et un opéra. Dans mon film Regardez bien les montagnes (2018), j’ai accompagné le travail d’écologistes qui baguent des chauve souris et des oiseaux, les mesurent, cherchent à comprendre leurs chemins de migration : ces gestes scientifique tiennent par excellence de la domination, de la maîtrise, de la subordination. La culture moderne ne connaît pas d’autre type de relation que la mise en mesure, en captivité, en domination. Pour la culture dominante qu’est la culture occidentale, c’est la norme. Il fait nuit en Amérique se clôture par le plan d’une chute d’eau au ralenti : il s’agit de regarder sous une autre optique temporelle le déploiement de la vie et du vivant. Je voulais terminer avec l’image de chute, d’un effondrement, mais aussi d’une force puissante. Je veux faire un cinéma du vivant, des pluies… Si on regarde bien cette image, des choses invisibles peuvent y apparaître. Les scientifiques nous disent que nous allons vivre des événements climatiques intenses. Tous les chamanes d’Amazonie nous disent que les éléments s’adressent à nous : il faut les écouter.
Il fait nuit en Amérique, film documentaire d’Ana Vaz, actuellement en salles.
