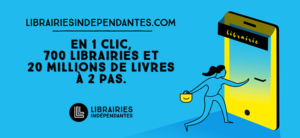Adieu veaux, vaches, cochons…
Comme chaque année à la même époque depuis plus de cinquante ans, le Salon de l’agriculture (SIA), décrit par ses promoteurs comme la « plus grande ferme de France », a accueilli ses 600 000 visiteurs pour une démonstration sans fausse note de la grandeur de l’agriculture française et de ses irréductibles liens avec nos concitoyens. Cette année, le SIA, placé sous le signe de Haute, vache Aubrac dont les portraits ont tapissé les murs du métro parisien, affirme cet attachement consensuel à notre agriculture par une déclaration mobilisatrice : « l’agriculture, une aventure collective ». De cela, les citadins s’en seront bien volontiers laissé convaincre alors qu’ils caressaient avec leurs enfants les petits cochons gascons ou, avec plus d’appréhension, les vaches Salers en dépit de la recommandation réitérée de ne pas toucher les animaux. Or c’est précisément ce que veulent les citadins, enfin voir des vaches et des cochons et tester la réalité de leur présence en les caressant. Car lequel d’entre eux sait quelle texture a la toison d’un mouton ou les soies d’un cochon ?
Alors, l’agriculture une aventure collective ? Je me propose de mettre en doute ce postulat en me focalisant sur la partie la plus visible de l’agriculture au SIA, l’élevage. Mais quel élevage ? Et quelle place les animaux de ferme ont-ils dans cette aventure ?
L’agriculture peut-elle être considérée comme une aventure ? Il y a dans cette notion une part d’imprévisibilité qui ne reflète pas en réalité l’évolution de l’agriculture depuis sa prise en main par la science et par l’industrie. A partir du XVIIIe siècle, et encore plus nettement à partir du XIXe siècle avec la naissance du capitalisme industriel, l’agriculture est un secteur d’activité dont il est attendu qu’il soit productif et rentable et qu’il assume sa visée exportatrice, témoin de la grandeur de la France. Tout le développement agricole depuis deux siècles, et sans surprise aucune, a consisté à accroître la productivité et l