Les ressorts psychologiques cachés de la croissance
Certains croyaient la croissance rangée au rayon des accessoires démodés, voire dangereux. Depuis une dizaine d’années, d’autres indicateurs commençaient à concurrencer le revenu par habitant en tant qu’objectifs de la politique publique. Bien-être, bonheur, développement durable, responsabilité sociale, autant d’objectifs légitimes pour une société devenue lucide sur les illusions de la croissance, ainsi que les problèmes environnementaux qu’elle entraîne. Et puis, depuis la Grande récession déclenchée par la crise des subprime aux Etats-Unis, puis la crise de la dette publique en Europe, la croissance était devenue introuvable, et il fallait apprendre à s’y habituer, voire à s’en réjouir. Mais la voici de retour, voici le chômage en baisse et le moral de la population au zénith. Alors, à quel moment se trompe-t-on ? L’amour de la croissance est-il une fatalité anthropologique, ou bien un travers dont il serait possible de guérir ?
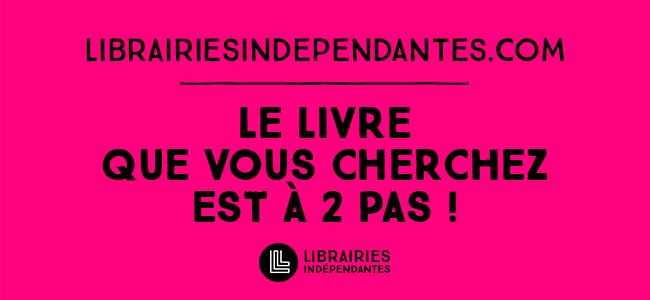
Bien entendu, le retour de la croissance est une bonne nouvelle. Elle fait reculer le chômage qui est source de dépression. Elle améliore le pouvoir d’achat des ménages, leur donnant une plus grande liberté de choix de consommation, la consommation étant finalement l’une des modalités de l’exercice de notre puissance d’agir. A un niveau plus global, sur longue période, la croissance, va de pair avec l’élévation de l’espérance de vie et du niveau d’éducation de la population. On observe même généralement une extension du secteur public, notamment des dépenses de santé, au fur et à mesure qu’un pays se développe. La croissance économique est donc porteuse d’une accessibilité étendue des biens que le philosophe John Rawls appellerait « essentiels », ou encore des « capacités » humaines fondamentales à l’aune desquelles se juge une société, selon l’économiste et prix Nobel Amartya Sen.
La question est savoir si la croissance restera éternellement porteuse d’une amélioration du bien-être des populations, ou si cette relation est des
