Pour un « capital d’émancipation »
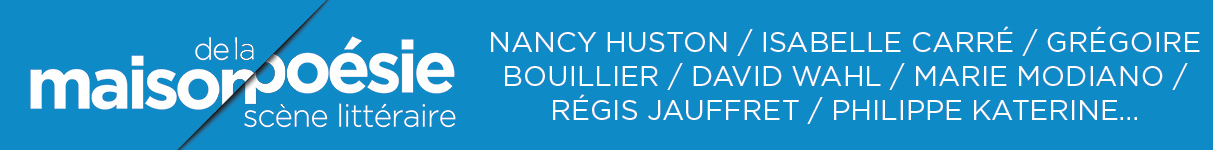
Depuis quelques années, le débat sur le revenu d’existence, revenu de base ou revenu universel, s’est installé dans le paysage politique. Tout d’abord porté par des universitaires, et des promoteurs associatifs, il s’est retrouvé propulsé dans les primaires des Républicains et du Parti Socialiste, puis bien plus clairement dans la campagne présidentielle de Benoît Hamon. L’idée fait donc son chemin sans pour le moment faire l’unanimité. L’un des arguments qui lui est le plus souvent opposé se veut une défense du travail, dans sa fonction à la fois sociale et morale, mais aussi l’affirmation de la possibilité de continuer à créer des emplois dans l’économie de demain. Or, si un tel revenu inconditionnel est bien une réponse possible à la raréfaction annoncée de l’emploi – notamment avec la robotisation – il permet également de sortir la source de revenu de la seule sphère salariale. En ce sens, il ne serait en rien contraire au travail, mais il permettrait d’assurer des ressources en dehors de l’emploi salarié. Il deviendrait un socle inaliénable, c’est en cela qu’il faut selon nous le considérer comme un droit lié à la naissance, qui répondrait à la question essentielle de la dignité des êtres humains, de manière universelle et inconditionnelle.
À cette idée du revenu d’existence, il faut ajouter des propositions « sœurs » qui se retrouvent occasionnellement dans le débat mais restent discrètes, parfois même considérées comme concurrentes, et qui suggèrent de préférer une « dotation en capital ». Les chercheurs américains de l’université américaine de Yale, Bruce Ackerman et Anne Alstott, ont fait par exemple la proposition de donner à 21 ans une dotation universelle de 80 000 dollars, avec des mécanismes d’accompagnement pour que cet argent, même dans une perspective libérale, puisse tout de même être utilisé de manière éclairée et responsable. La proximité avec le revenu d’existence est en partie assumée par le fait que le bénéficiaire pourrait tout à f
