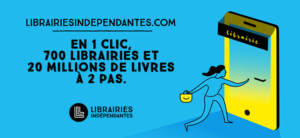Trente-quatre mille trois cent soixante et un
C’est une vidéo qui dépasse à peine la minute. Il y a quelques jours, pour annoncer la publication, dans un insert spécial de 56 pages, du recensement des 34 361 victimes de la forteresse Europe officiellement répertoriées, le journal italien Il Manifesto a demandé à certains de ses collaborateurs d’en lire des extraits. C’est-à-dire en réalité de prononcer à voix haute ce qui, de ces vies, a disparu avec elles – et ce qui nous en reste, à nous, qui sommes réduits à les compter : parfois un nom complet, parfois une origine, parfois encore un âge. « Inconnu », « inconnue », « nom non parvenu », « enfant de sept ans », « somalien », « bébé de huit mois », « origine inconnue », « quatre enfants », « femme de soixante-trois ans », « Ahmed Hassan », « 22 octobre 2015 », « noyée en mer Égée », « Irak », « renversé par une voiture à Calais », « douze corps », « femme afghane inconnue », « garçon de quinze ans », « jeune homme de vingt ans », « Syrie ».
Donner le nom des morts et dire aussi, souvent, notre incapacité à les nommer, est une manière de faire un tombeau : notre indignation et notre désespoir sont finalement tout ce que nous avons à leur offrir en guise de sépulture. Mais l’atrocité de cette liste, saisissante dès qu’on en tourne les pages, ne suffit pas à expliquer le trouble étrange qu’elle suscite dès lors qu’elle est prise en charge par la voix. C’est ce trouble-là, à la fois énigme et douleur sourde, dont j’aimerais rendre raison. Après tout, ces nombres, nous en connaissons la monstruosité ; nous savons les images auxquelles ils correspondent et que montrent jour après jour les écrans dont nous sommes en permanence entourés. Pour certains d’entre nous, la diffusion de l’information est aussi un terrain de bataille quotidien : lire la presse, éplucher les rapports, publier sur les réseaux sociaux, relayer, faire circuler, transmettre. En somme : nous ne découvrons rien que nous ne sachions déjà – trente-quatre mille trois cent soixante et un, nou