Entre Ancien et Nouveau Monde, une autre voie est possible
La France serait donc l’homme (la femme ?) malade de l’Europe. Elle serait l’un des derniers pays à refuser l’entrée dans le Nouveau Monde, à ne pas vouloir renoncer à ses vieux rites, ses traditions, ses vénérables oripeaux datant de la dernière Guerre – et elle en paierait le prix fort. Tel est le discours que nous avons entendu lors de la dernière campagne présidentielle et depuis : la France, peuplée de « Gaulois réfractaires au changement », serait le seul des grands pays d’Europe à avoir un taux de chômage élevé, une croissance faible et à ne pas encore avoir engagé les réformes courageuses et nécessaires lui permettant de s’adapter à la fois à la globalisation et à la révolution technologique – qui exigent de la population flexibilité, réactivité, capacité à changer et effort budgétaire.
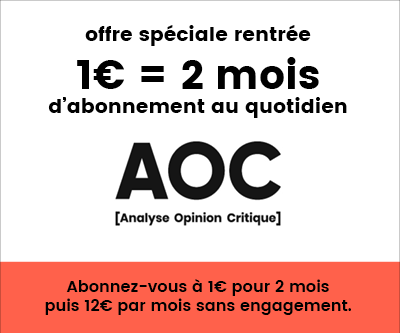
Nous serions les seuls à avoir conservé un Code du travail lourd et rigide, un modèle social affreusement couteux et inefficace, des syndicats peu aptes au consensus, des dépenses publiques excessives et une dette abyssale. Il nous faudrait donc, pour conserver notre place dans le monde, nous engager dans un véritable processus disruptif, simplifier radicalement le Code du travail, réduire la dette et les dépenses publiques, attirer coûte que coûte les investissements étrangers, remettre à tout prix les pauvres et les chômeurs au travail, abandonner un modèle social trop protecteur, bref, entrer dans le Nouveau Monde.
Le Nouveau Monde, au-delà de la droite et de la gauche, se caractériserait notamment par une nouvelle conception du rôle de l’État : un État non plus interventionniste, déversant, sur des bénéficiaires passifs et assignés à résidence du fait même de cette intervention, des prestations censées les aider à sortir de la pauvreté, du chômage ou d’un risque social ; mais un État accompagnateur, stratège, un État « capacitant » (enabling) ou émancipateur, cessant de prendre les populations par la main, d’en haut, mais les invitant à choisir elles–mêmes leur destin.
