Robert Faurisson, iconoclaste et antisémite
Dans une lettre retentissante publiée de guerre lasse par Le Monde en décembre 1978, celui qui était alors maître de conférence en littérature à l’université de Lyon II affirmait que les chambres à gaz, qui symbolisaient plus que toute autre chose le génocide des juifs, n’avaient pas existé et, partant, que le génocide lui-même était une invention. Comble de cynisme et d’indécence, l’auteur ajoutait que c’était là « une bonne nouvelle pour l’humanité ». Depuis lors, le mensonge a fait flores, sinon en Europe occidentale, du moins au Moyen-Orient : un quart de siècle plus tard, en décembre 2006, Faurisson fut l’invité d’honneur de la grande conférence négationniste organisée par l’Iran, un pays qui l’honora six ans plus tard d’un prix, remis par le président iranien en personne, Mahmoud Ahmadinejad, « honorant le courage, la résistance et la combativité » du vieux négationniste. Dans le mensonge aussi, il est donc après tout possible de faire carrière et d’avoir eu une vie réussie selon les critères qu’on s’était choisi.
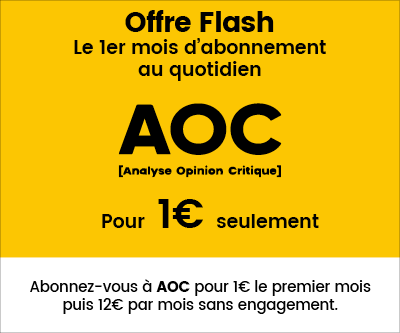 Faurisson n’était pas le premier à soutenir publiquement un tel non-sens, et il ne sera assurément pas le dernier. Il avait été précédé en la matière par Paul Rassinier (1906-1967), un militant socialiste déporté à Buchenwald et Dora pour fait de résistance qui, quelques années après la guerre, s’était mis à douter lui-aussi de l’existence de ce moyen perfectionné de mise à mort qui n’était pas employé dans les camps où il avait été emprisonné et où il avait souffert. Son Mensonge d’Ulysse, en 1950, fit scandale, mais c’est surtout la série d’ouvrages publiés dans les années soixante qui lui permit, grâce au renfort de l’extrême droite, en particulier de Maurice Bardèche, de devenir le « père fondateur » du « révisionnisme ». À la mort de Rassinier, avec lequel il avait été en contact, Faurisson reprit bientôt le flambeau. Au-delà de ses accointances idéologiques et de son très probable antisémitisme, c’est sans doute une puissante appétence icon
Faurisson n’était pas le premier à soutenir publiquement un tel non-sens, et il ne sera assurément pas le dernier. Il avait été précédé en la matière par Paul Rassinier (1906-1967), un militant socialiste déporté à Buchenwald et Dora pour fait de résistance qui, quelques années après la guerre, s’était mis à douter lui-aussi de l’existence de ce moyen perfectionné de mise à mort qui n’était pas employé dans les camps où il avait été emprisonné et où il avait souffert. Son Mensonge d’Ulysse, en 1950, fit scandale, mais c’est surtout la série d’ouvrages publiés dans les années soixante qui lui permit, grâce au renfort de l’extrême droite, en particulier de Maurice Bardèche, de devenir le « père fondateur » du « révisionnisme ». À la mort de Rassinier, avec lequel il avait été en contact, Faurisson reprit bientôt le flambeau. Au-delà de ses accointances idéologiques et de son très probable antisémitisme, c’est sans doute une puissante appétence icon
