La méritocratie ou l’envers de la démocratie
Dans la société actuelle, où la reproduction sociale bat son plein, les transclasses, qui franchissent les barrières de classe et connaissent une trajectoire économique, politique et culturelle, différente de leurs familles, sont souvent enrôlés dans le cadre de l’idéologie méritocratique comme des exemples à imiter ou à éviter, selon qu’ils accroissent ou perdent leur capital initial. La récupération politique des destinées singulières par la classe dirigeante a pour but de montrer qu’il n’y a pas de fatalité, que chacun est responsable de son sort et que tout dépend en dernier ressort de ses propres efforts.
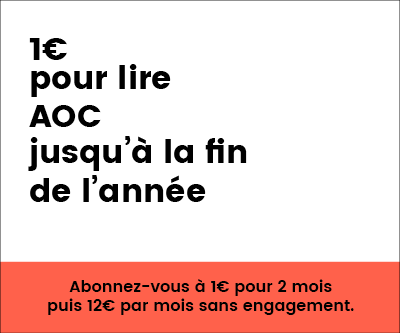
On comprend bien tout l’intérêt d’une telle démarche. D’une part, elle permet de soutenir que l’ordre social est juste, parce qu’il reflète les qualités réelles de chacun et ne fait que sanctionner les mérites de ceux qui connaissent une ascension et les fautes de ceux qui stagnent ou chutent, par paresse, négligence ou mauvaise volonté. Elle conforte ainsi la classe dominante et fragilise la contestation en la faisant passer pour de l’aigreur, de l’envie ou du ressentiment. D’autre part, elle permet d’embrigader les exclus du système en leur offrant l’espoir d’être un jour les élus. Ce faisant, elle les conduit à resserrer leurs chaînes en devenant eux-mêmes leurs propres bourreaux. La meilleure des dominations n’est-elle pas celle qui est incorporée par les dominés au point de la désirer ?
Car loin s’en faut que la défense de la méritocratie et du volontarisme soit l’apanage des dominants. Elle est assez largement partagée et c’est bien là le propre de l’idéologie que de s’imposer comme une croyance commune illusoire qui résiste à la vérité. L’illusion, étymologiquement, renvoie à ce qui se joue de nous. De qui ou de quoi sommes-nous alors le jouet quand nous convoquons l’explication toute faite et facile du mérite, au lieu de nous pencher sur les processus de fabrique des transclasses et d’analyser rigoureusement les causes complexes et multiples qui conco
