Les Gilets Jaunes ou le discrédit de la démocratie représentative
Heureux sont les commentateurs et dirigeants politiques qui ont pu discerner très tôt quelle était la nature et les objectifs du mouvement des Gilets Jaunes ! Pour ma part, je peine encore aujourd’hui à interpréter un mouvement traversé de courants contradictoires et paradoxaux. Dire que le mouvement des Gilets Jaunes ne correspond à aucun autre mouvement majeur dans l’histoire de France contemporaine est un euphémisme. Ce qui caractérisait les mouvements sociaux depuis mai 68, c’était leur grande lisibilité politique. Soit ils étaient déclenchés par les syndicats, rejoints ensuite par les partis politiques, soit ils étaient le fait d’actions catégorielles spontanées (lycéens, infirmières, cheminots) mais, très vite, ils étaient encadrés par les syndicats et les partis politiques.
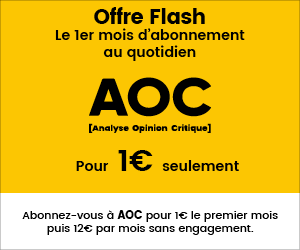
Dans tous les cas de figure, ils s’inscrivaient dans le jeu de la démocratie représentative, née avec l’établissement, puis l’extension progressive du suffrage universel. La division du travail de représentation était claire et nette : aux syndicats la défense des intérêts catégoriels des travailleurs et aux partis politiques la tâche d’articuler ces revendications catégorielles en propositions politiques par le canal des institutions politiques (parlement, gouvernement).
La démocratie représentative est un régime dans lequel les citoyens sont gouvernés par l’intermédiaire de leurs représentants élus à qui ils délèguent leur pouvoir. Il faut noter que les fondateurs de ce mode de gouvernement l’opposèrent à la notion même de démocratie. Emmanuel-Joseph Siéyès reconnaissait l’opposition entre, d’une part, le gouvernement représentatif républicain et la démocratie.[1] Dans un discours prononcé après la début de la révolution, Siéyès, pour qui le Tiers-État (le peuple) était « tout », articulait sans détour la distinction entre les deux régimes : « Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d’entre eux. Sans aliéner leurs droits, ils en commentent l’exercice. C’est pour
