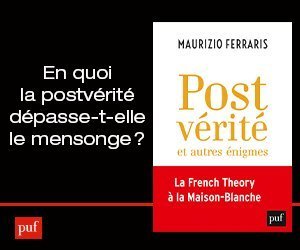Face au présent, défendre la raison
En France, le pacte républicain dans sa version « athénienne » repose sur la raison. Cette dernière constitue le socle de l’action, fonde l’argumentation, rejette dans l’illégitimité ceux qui n’en respectent pas les règles. Elle put même passer pour une déesse castratrice, aux horizons fermés, intolérante et incapable d’accueillir les audaces de la pensée ou les aventures esthétiques. Les Lumières – la Raison en actes – n’avaient pas en effet tout éclairé et la Révolution française qui lui avait ménagé un trône en fit une arme redoutable mise au service de pratiques trahissant ses principes. Il n’en demeure pas moins que les noces de la République et de la raison sont anciennes et les infidélités toujours dénoncées.
La Raison fut donc, avec passion, la grande puissance régulatrice des régimes républicains successifs. La IIIe République, qui occupe la place que l’on sait dans toutes les nostalgies républicaines faisant du déclin le moteur de l’histoire, en est la plus parfaite illustration. Contrôleuse des émotions qu’elle juge négatives et menaçantes, accusées d’obscurcir toute lucidité critique, elle en appelle à la retenue, au maintien. Elle se garde des personnalités : « Oui, s’époumonait Gambetta, crions, quand cela convient et quand cela résume, comme dans un mot suprême, toutes nos aspirations, crions Vive la République ! mais, ne crions jamais – du moins autant que nous le pourrons ! – ne crions jamais Vive un homme ! »
Dans cette lignée, la politique ne doit être remise qu’entre les mains d’hommes raisonnables : ceux dont la réputation atteste le savoir, la culture et la réflexion. C’est la science qui doit présider à la prise de décisions. C’est la controverse argumentée qui doit assurer la gestion du désaccord. Le Parti politique, tel qu’il surgit comme acteur de la vie politique dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, n’est pas seulement un outil de conquête ou de gestion du pouvoir. Il est aussi un lieu de formation et un instrument