L’éthique à l’épreuve des sciences : logique et médecine
« J’ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire et la logique. On se rend compte cinquante ans après, qu’ils ont conjuré de grands périls » (Proust, Le temps retrouvé). Il y a des questions, qui sans être reformulées, engendrent sur le long terme des crampes mentales aux effets pernicieux. « Tenter de penser l’impossible et ne pas y parvenir »[1], voilà le processus qui déclenche la crampe mentale. Prenons l’exemple du conflit supposé entre « foi et raison ». Beaucoup s’échinent à construire une opposition ou une dualité, là où il n’y a en fait qu’une distinction. Le cinquième considérant de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen proclame la « foi dans les droits fondamentaux » de l’homme. Qui s’aventurerait à dire que cela entre en conflit avec la raison ?
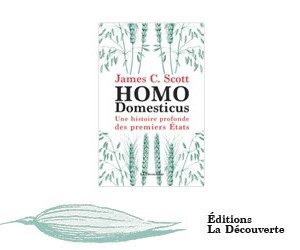
Le mot de « foi », comme celui de piété signifie seulement que l’on cesse de chercher des raisons, que l’on prend un point de départ sans justification, et non que l’on s’oppose à la raison. En revanche, il est sûr qu’il y a une opposition claire entre la superstition et la raison et que beaucoup, dans l’histoire de l’humanité, ont pris la foi pour de la superstition, et pensent ne pouvoir vivre la religion de manière concrète que lorsqu’elle a une bonne dose de superstition. Les analyses de Spinoza dans l’appendice du livre I de L’Éthique restent, à ce titre, exemplaires. Nous convoquons Dieu, et la foi en lui, à chaque fois que nous n’avons pas d’explication, là où la recherche des raisons est non seulement pleinement légitime mais surtout, efficace. Nous finissons par faire de Dieu « l’asile de l’ignorance ».
De fait, bien avant Proust, Montaigne avait souligné le danger des formulations biaisées : « La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes » ( Essais, II), ajoutant que « tous les abus du monde s’engendrent de ce qu’on nous apprend à craindre de faire profession de notre ignorance ». Chacun y va de son explication, quitte à dire des choses extravagantes
